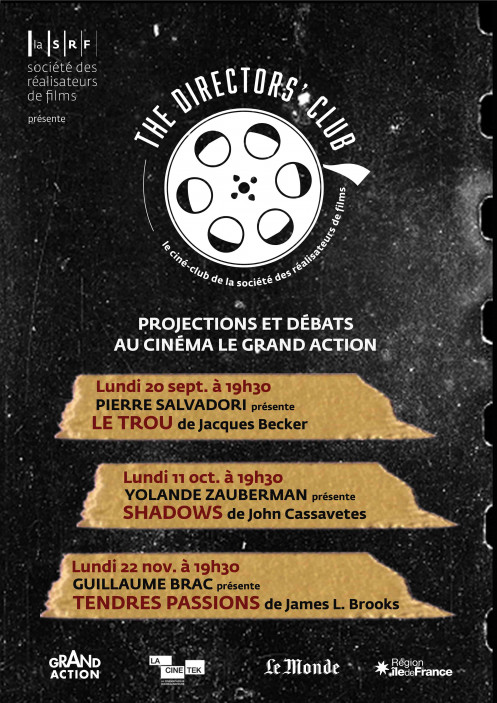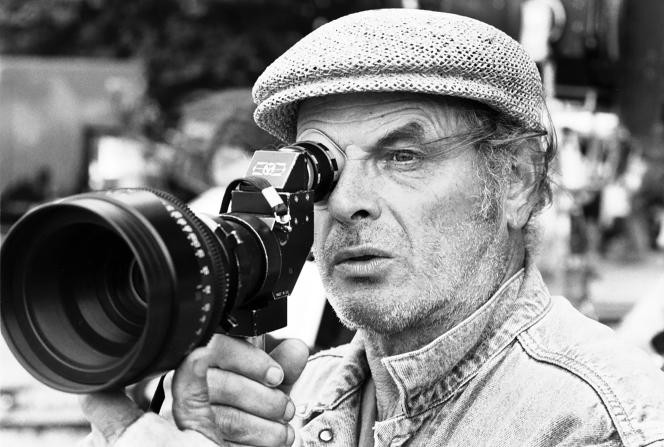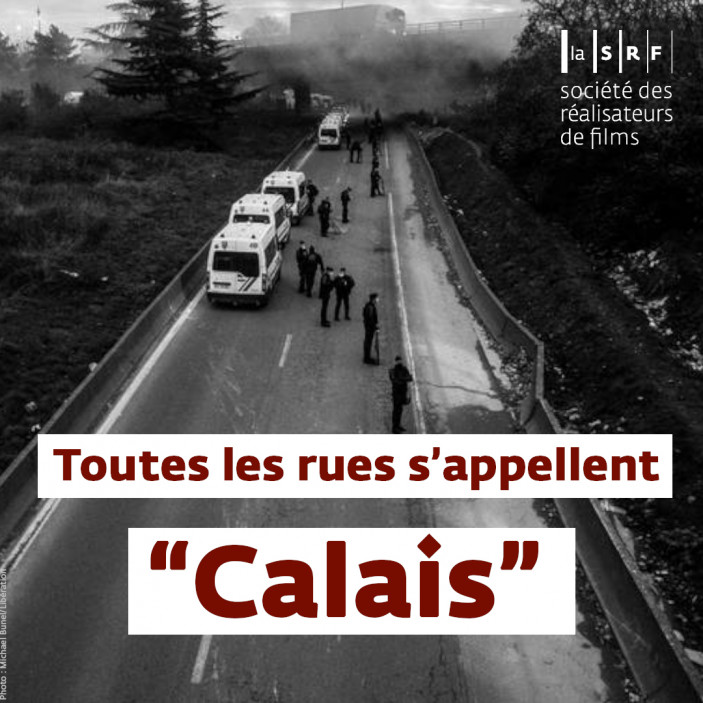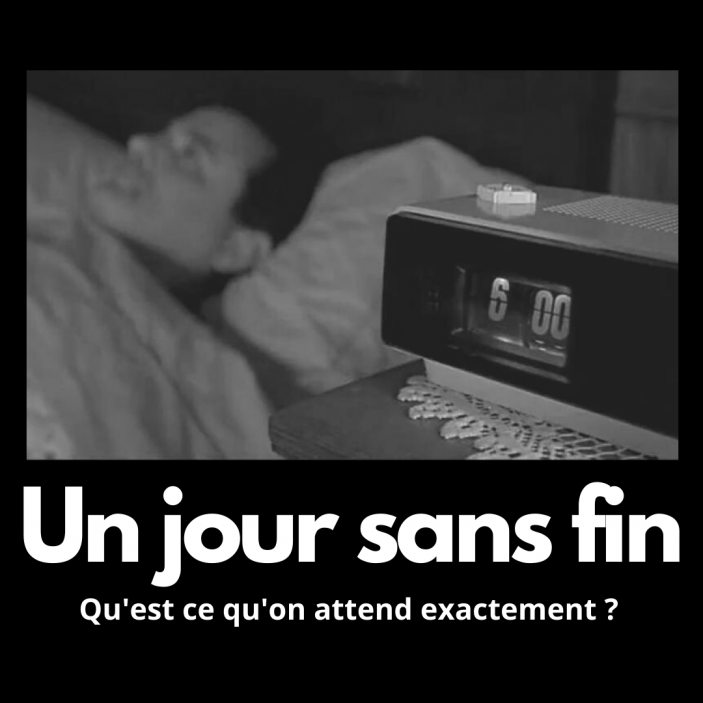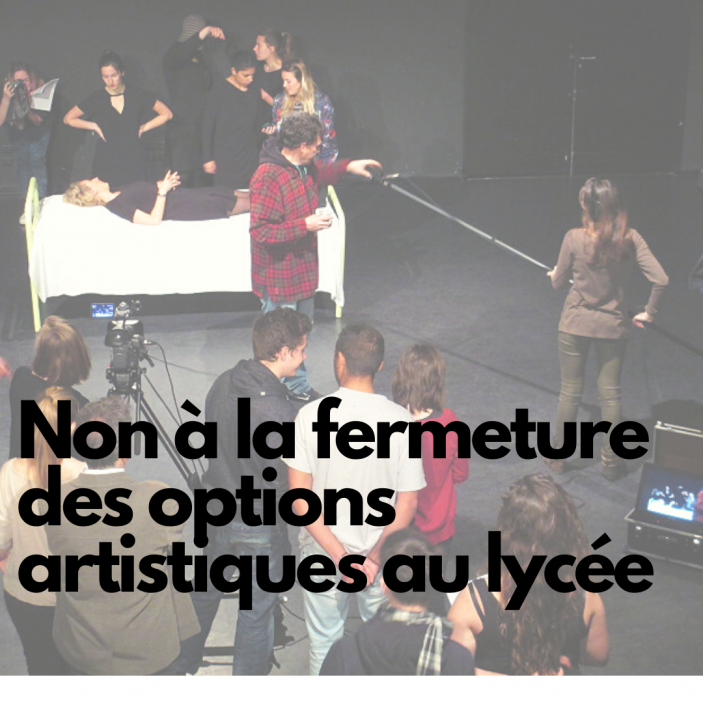archives
- BLOC
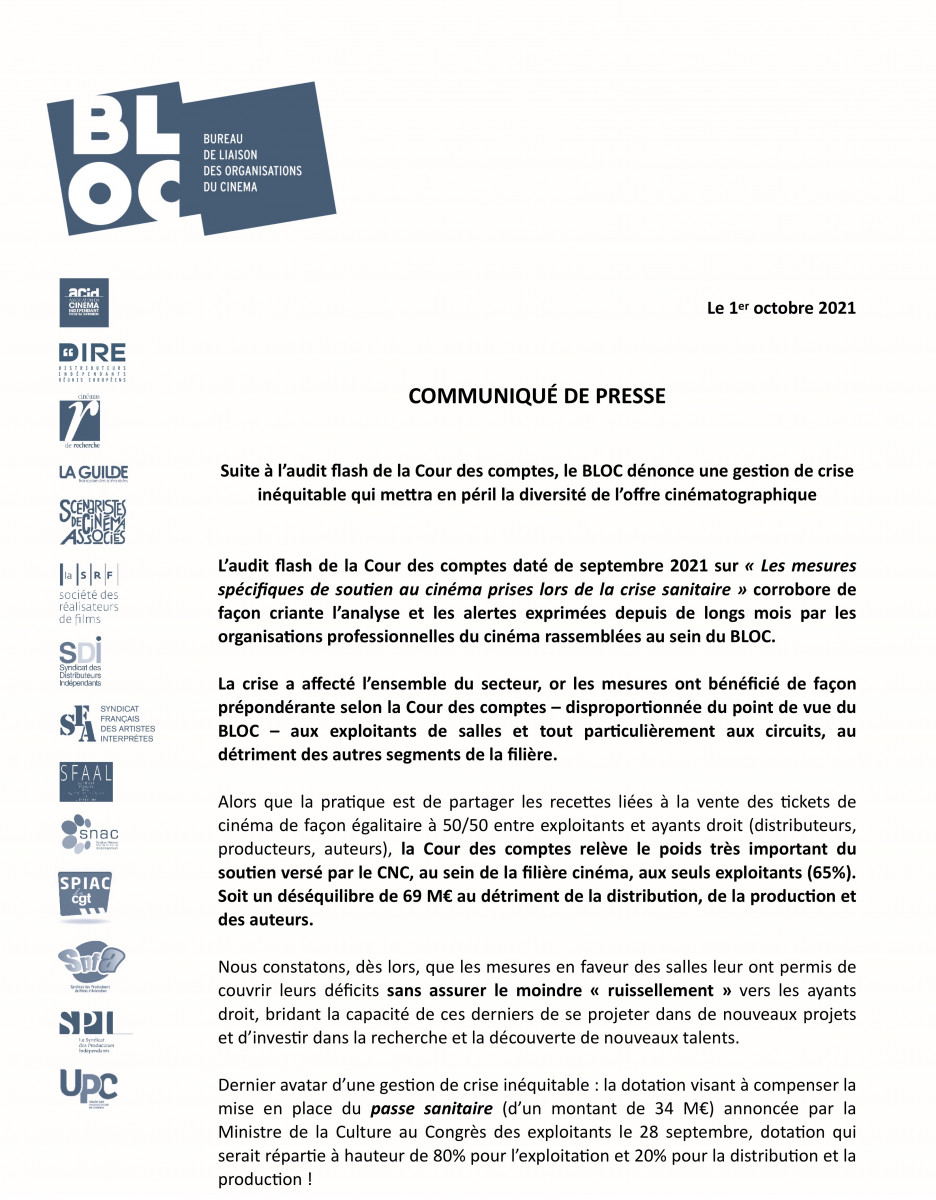
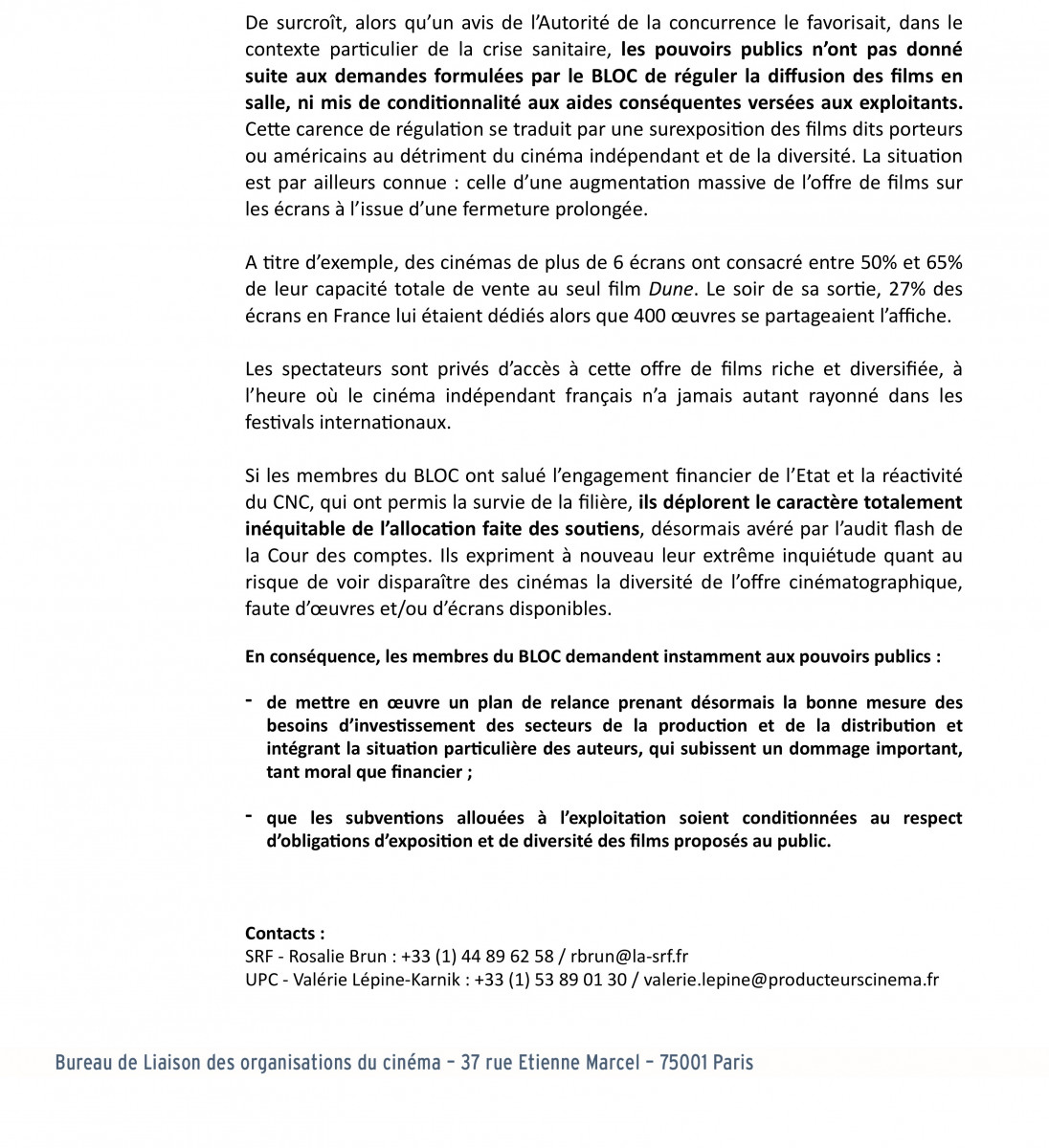
- BLOC
- CNC
Communiqué
17 septembre 2021
Nouveaux collèges de l'Avance sur recettes
La SRF salue le renforcement financier de l’Avance sur recettes et se réjouit de la création à titre expérimental d’un quatrième collège destiné spécifiquement aux deuxièmes et troisièmes films, qu'elle appelait de ses vœux depuis longtemps.
Nous regrettons cependant, dans la nouvelle composition des trois collèges de l'Avance avant réalisation, la quasi-absence de représentants du cinéma documentaire, alors que le soutien à ces films est indispensable et nécessite une attention particulière.
Pour nous cinéastes, en cette période de bouleversements et d'incertitudes des modes de financement et de diffusion de nos œuvres, l’Avance sur recettes reste plus que jamais un dispositif essentiel de la politique culturelle, grâce auquel des films importants peuvent exister chaque année. Pour certains projets, elle doit d'ailleurs pouvoir être un premier levier. Elle est garante du renouvellement artistique et du maintien de la diversité de notre cinéma ; il convient de rester vigilant quant à ce rôle prescripteur.
Nous souhaitons donc bienvenue et clairvoyance à l'ensemble de ses nouveaux membres pour le travail qui les attend. Nous espérons qu'ils prendront la mesure de la responsabilité qu'il leur est donnée et œuvreront au sein de cette institution si particulière et vertueuse, au soutien d’un cinéma indépendant et audacieux.
La Société des réalisateurs de films
Contact presse
Rosalie Brun, Déléguée générale - rbrun@la-sfr.fr
- CNC
- SRF
Communiqué
Le 15 septembre 2021
Nouveau Conseil d’administration de la SRF
2021/2022
À la suite de l’Assemblée générale du 4 septembre 2021, le Conseil d’administration de la SRF s’est réuni et a procédé à l’élection de son bureau pour l’année 2021/2022 :
Co-Présidents : Thomas Bidegain, Frédéric Farrucci, Zoé Wittock
Co-Secrétaires : Lucie Borleteau, Valérie Osouf
Trésorier : Romain Cogitore
-
Conseil d'administration :
Jacques Audiard, Barbara Balestas-Kazazian, Antoine Barraud, Mikael Buch, Malik Chibane, Philippe Faucon, Emmanuel Gras, Vergine Keaton, Marie-Castille Mention-Schaar, Sylvain Pioutaz, Katell Quillévéré, Axelle Ropert, Pierre Salvadori, Claire Simon, Leila Touati, Denis Walgenwitz, Éléonore Weber
Face aux échéances politiques et aux nombreux combats que devra mener la SRF cette année, nous ont rejoints en tant que membres d'honneur :
Marie Amachoukeli, Bertrand Bonello, Catherine Corsini, Yann Gonzalez, Robert Guédiguian, Éric Guirado, Laurent Heynemann, Cédric Klapisch, Serge Le Péron, Nicolas Philibert, Aude Léa Rapin, Chantal Richard, Coline Serreau, Bertrand Van Effenterre, Christian Vincent, Rebecca Zlotowski
Contact presse
Rosalie Brun - Déléguée générale - rbrun@la-srf.fr
- SRF
Communiqué de presse
Le 29 juillet 2021
Jean-François Stévenin, l'éternel voyageur du cinéma
Partout où il allait, Jean-François Stévenin emportait avec lui un petit appareil photo, sans doute pour capturer des bribes des mille et un territoires de cinéma sur lesquels il a eu l’audace de s’aventurer. En tant que cinéaste, il a su composer en seulement trois films une œuvre qui reste à ce jour une inspiration et un modèle de liberté pour des cinéastes du monde entier.
Formé comme assistant mise en scène sur des films d’Alain Cavalier, François Truffaut, Jacques Rivette, Barbet Schroeder ou Jacques Rozier, Jean-François Stévenin a envisagé toute sa vie le cinéma comme une aventure collective, comme un art majeur de la camaraderie. Sur un plateau de tournage, il donnait d’ailleurs toujours l’impression d’être un technicien de plus, trouvant plus volontiers sa place auprès des machinos et des électros que dans la solitude d’une loge.
En lui confiant le rôle de l’instituteur dans L’argent de poche, François Truffaut fut le premier à comprendre que sa présence, à la fois brute et délicate, passionnée et enfantine, était avant tout une pure présence de cinéma. Depuis, Jean-François Stévenin a baladé son allure tendre et malicieuse dans les films de Paul Vecchiali, Luc Béraud, Jacques Rivette, John Irvin, Philippe De Broca, Juliet Berto, Jean-Henri Roger, John Huston, Jean-Pierre Mocky, Jacques Demy, Jean-Luc Godard, Bertrand Blier, Gérard Krawczyk, Raoul Ruiz, Marco Ferreri, Catherine Breillat, Pascal Thomas, Patricia Mazuy, Patrick Grandperret, Eric Rochant, Alexandre Arcady, Danthe Desarte, Pascal Kané, René Féret, Pierre Salvadori, Laetitia Masson, Werner Schroeter, Thomas Lilti, Philippe Ramos, Jim Jarmusch, Antony Cordier, Mikael Buch, Ursula Meier, Samuel Collardey, Éric Barbier, Guy Maddin, Julien Samani, Xavier Giannoli et tant d’autres…
Mais si Jean-François Stévenin a su voyager au cœur du cinéma, c’est avant tout grâce aux trois chefs d’œuvres qu’il a écrit et réalisé : Passe Montagne en 1978, Double Messieurs en 1986 et Mischka en 2002.
Dans un cinéma français qui s’affirme souvent par le dialogue, il a inventé un cinéma du vivant où chaque geste, chaque éclat et chaque son composent une mélodie à la fois précise et sauvage. Ses films, intuitifs et picaresques, sont faits de chemins de traverse qui dessinent une cartographie personnelle de la France. Sur les routes de cette France-là, Louis-Ferdinand Céline et Johnny Hallyday se promènent en voiture, à pied ou en hélicoptère, à la recherche de John Cassavetes, le « cousin américain ».
Nous souhaitons bonne route à Jean-François Stévenin.
La nôtre restera à jamais éclairée par son regard.
Contact presse : Rosalie Brun /rbrun@la-srf.fr/ 01.44.89.62.58
Présente chaque année au Festival de cinéma Brive - Rencontres Internationales du Moyen Métrage - la Société des réalisateurs de films (SRF) organise une table ronde autour de l’actualité de la profession.
En 2021, à l'occasion de la 18e édition du Festival, la SRF proposait : « Cinéma : quelles politiques territoriales pour les auteurs ? »
Présente chaque année au Festival de cinéma Brive - Rencontres Internationales du Moyen Métrage - la Société des réalisateurs de films (SRF) organise une table ronde autour de l’actualité de la profession.
En 2021, à l'occasion de la 18e édition du Festival, la SRF proposait : « Cinéma : quelles politiques territoriales pour les auteurs ? »
Les collectivités – en particulier les Régions et leurs établissements – ont aujourd’hui un rôle incontournable en matière de cinéma. De la création à la diffusion, leur intervention a transformé la géographie du secteur et la vie des oeuvres. En documentaire comme en fiction, en prise de vues réelles comme en animation, comment naissent des politiques territoriales à l’endroit spécifique de la création ? Quel dialogue est possible entre auteurs, élus et responsables des dispositifs ? Autant de questions pour la politique économique et culturelle à venir.
Intervenants : Les cinéastes et scénaristes Lucie Borleteau, Jean-Raymond Garcia, Alexandre Lança, Denis Walgenwitz (membres de la SRF), Marion Desseigne-Ravel (membre du SCA), et Perrine Vincent, conseillère auteur du CNC.
Animée par : Raphaël Laforgue, délégué général adjoint de la SRF
Avec Chloé Guerber-Cahuzac, Nicolas Klotz et Hind Meddeb, animée par Valérie Osouf.
Cette école a été publiée simultanément à la tribune de la SRF "Toutes les rues s'appellent Calais" que vous pouvez lire dans Libération.
Vous pouvez soutenir les associations qui mènent des actions en faveur des personnes exilées dont :
La Cabane Juridique - Legal Shelter
Extraits :
- PARIS STALINGRAD, de Hind Meddeb
- HÉROIQUE LANDE, de Nicolas Klotz
- EN TERRITOIRE HOSTILE, de Chloé Guerber-Cahuzac.
- Ecole
Avec Chloé Guerber-Cahuzac, Nicolas Klotz et Hind Meddeb, animée par Valérie Osouf.
Cette école a été publiée simultanément à la tribune de la SRF "Toutes les rues s'appellent Calais" que vous pouvez lire dans Libération.
Vous pouvez soutenir les associations qui mènent des actions en faveur des personnes exilées dont :
La Cabane Juridique - Legal Shelter
Extraits :
- PARIS STALINGRAD, de Hind Meddeb
- HÉROIQUE LANDE, de Nicolas Klotz
- EN TERRITOIRE HOSTILE, de Chloé Guerber-Cahuzac.
- Ecole
En octobre 2015, à l’initiative de quelques cinéastes, l'Appel de Calais, signé par 800 personnalités et publié dans Libération, était lancé pour alerter l’opinion publique et interpeller le gouvernement sur les conditions indignes des personnes exilées dans la dénommée « Jungle de Calais »
En octobre 2015, à l’initiative de quelques cinéastes, l'Appel de Calais, signé par 800 personnalités et publié dans Libération, était lancé pour alerter l’opinion publique et interpeller le gouvernement sur les conditions indignes des personnes exilées dans la dénommée « Jungle de Calais »
3 mai 2021
Toutes les rues s'appellent "Calais"
En octobre 2015, à l’initiative de quelques cinéastes, l'Appel de Calais, signé par 800 personnalités et publié dans Libération, était lancé pour alerter l’opinion publique et interpeller le gouvernement sur les conditions indignes des personnes exilées dans la dénommée « Jungle de Calais ». Ce bidonville d’État aura compté jusqu'à 12 000 femmes, hommes et enfants, dont nombre de mineurs isolés, parmi lesquels plusieurs centaines sont portés disparus.
Dans l’élan de cet Appel, un collectif devenu association fut créé pour répondre à un besoin fondamental et pourtant inaccessible sur la zone : l’accès au droit. La Cabane Juridique - Legal Shelter a ainsi rassemblé des juristes et avocats bénévoles, pour tenir une permanence sur place, notamment orientée vers l'aide au transfert des familles et des mineurs isolés vers le Royaume-Uni, et la défense des victimes de violences policières.
Le bidonville de Calais a été détruit à la fin 2016, sans aucune solution pérenne pour les personnes qui y vivaient. Cinq ans plus tard, qu'en est-il de la prise en charge de leur accueil par l'État et des conditions de travail des associations sur le terrain ?
Une chasse aux « points de fixation », la peur d’un « appel d’air », de « l'invasion » sont entretenues pour servir des politiques toujours plus autoritaires et mortifères. Une traque des personnes exilées par les forces de l’ordre s’est étendue du Calaisis à la région parisienne et à la frontière italienne. Éparpillées, exténuées, elles survivent dans des bois, sur des terrains vagues, sous des ponts, où leurs campements précaires sont systématiquement dispersés, contraintes d’errer, dans une tourmente absurde et sans fin.
Aux marges de notre espace social, ces pratiques de répressions permanentes s'accompagnent d'une invisibilisation de la présence des personnes exilées, confortée par des directives préfectorales silencieuses.
Ces politiques, qui font prévaloir l’isolement sur la solidarité et l’expulsion sur l’accueil, rendent de plus en plus difficile l’accompagnement des associations, collectifs et citoyens solidaires. La situation d'extrême vulnérabilité dans laquelle les personnes exilées sont maintenues, sans espace de sécurité ni même souvent de possibilité de dormir, empêche de réfléchir avec elles à des solutions à long terme.
Comment maintenir le lien quand des distributions de nourriture sont interdites, gazées par les forces de l'ordre, quand les tentes et les vêtements sont confisqués et détruits, même en plein hiver ? Comment défendre leurs droits, quand chaque jour est une nouvelle situation d’urgence ? Et ce dans un contexte de pénalisation où des personnes solidaires se voient même accuser de « délit de solidarité » ! Le 23 avril dernier encore, le procureur du tribunal de Gap a requis 2 mois de prison contre deux maraudeurs de l’association Tous Migrants.
Cette criminalisation de la solidarité est indigne d’un État qui se défausse perpétuellement de sa responsabilité sur les associations et les bonnes volontés. D’un État qui maintient l’errance d’un côté tout en dissuadant les soutiens de l’autre, rendant la vie impossible aux personnes exilées sur le territoire français. Depuis juin 2015, rien que dans la région parisienne, on dénombre une soixantaine de suicides parmi elles, sans évoquer la tragédie des dépressions, accès psychotiques et des addictions diverses, liées à une précarité accentuée par la maltraitance institutionnelle.
Entre 2018 et 2019, 978 démantèlements de campements ont été enregistrés entre Calais et Grande Synthe. Depuis 2015, à Paris, Aubervilliers et à Saint-Denis, ce sont 65 campements qui ont été dispersés. Le cadre juridique de ces « évacuations » est volontairement flou, voire inexistant. Celle du campement de la Porte de Saint-Denis et de celui de la Place de la République en novembre 2020, en furent les lamentables démonstrations. Présentées comme des « mises à l'abri », ces opérations policières relèvent du harcèlement et traduisent les dysfonctionnements des systèmes d’hébergement : de fait, 80% des personnes sont de nouveau à la rue 30 jours plus tard, dont 25% dans les 72 heures.
Des « périmètres de sécurité » sont systématiquement mis en place à chaque démantèlement, au mépris du droit d'informer, empêchant ainsi de filmer la réalité des pratiques des forces de l’ordre. Ceci alors que les témoignages et les preuves de violences policières envers les personnes exilées ne cessent de s'accumuler, permettant de rendre publiques ces violations des droits humains. La Cabane juridique a ainsi porté 50 plaintes devant la justice pour une seule condamnation pour violences à ce jour. Désormais, elle porte plainte directement contre l’État et non contre les individus policiers. Plus de la moitié des plaintes sont classées sans suite, souvent au prétexte que l’on ne pouvait identifier l’auteur des faits.
Comment ne pas faire le lien avec l’article 24 de la funeste loi dite « Sécurité Globale », qui vient d’être entérinée par les deux chambres ?
Comment ne pas voir qu'il s'agit là d'une politique globale, qui dans un état d’urgence toujours prolongé voudrait ôter de notre vue ces pratiques de répression ? Une politique qui voudrait nier la présence des personnes exilées, dans un contexte aggravé par la crise sanitaire, où elles sont encore davantage précarisées et toujours plus démunies de droits.
Nous demandons l’arrêt immédiat des pratiques illégales de démantèlement, de destruction d’abris et de confiscation de biens personnels.
Nous rappelons à la prise en charge inconditionnelle des personnes exilées sur l’ensemble du territoire et à la mise en place d’une véritable politique d’accueil, dans un cadre digne et respectueux.
Nous demandons à chacune et à chacun de prendre la mesure de cet état de fait, pour que cesse cette cruauté à l’encontre des personnes les plus fragilisées, qui n’ont pas bravé les pires dangers dans leurs pays et sur les routes de l’exode pour venir mourir dans l’un des pays les plus riches du globe.
***
La Cabane Juridique poursuit ses actions auprès des personnes exilées, comme de nombreuses autres associations, grâce à la mobilisation de leurs bénévoles. Leurs financements proviennent uniquement de collectes, d’adhésions et de dons ponctuels. Elles ont besoin de soutien.
La Cabane juridique - Legal Shelter (Calaisis)
Solidarité Migrants Wilson (Région parisienne)
- Social
- SRF
Le 23 avril 2021
Une honte française
À l’heure où la justice états-unienne reconnaît l’horreur des violences policières, la France, elle, recule.
Le parallèle entre la puissance symbolique du verdict à l’encontre de Derek Chauvin, policier coupable du meurtre de Georges Floyd, et le passage dans une impunité totale et méprisante de la loi "sécurité globale" en France est une honte, une douleur, un couteau dans le cœur. Dans les délibérations des jurés qui ont abouti au verdict final de l'affaire Floyd, nul ne peut ignorer l’importance absolue des vidéos tournées par les témoins avec leurs téléphones portables.
Aujourd’hui, par cette loi, l'État français, celui-là même qui a laissé glisser le vocabulaire de « gardien de la paix » vers « force de l’ordre », ne permettra plus à un tel exemple de justice d’avoir lieu sur son sol.
La loi "sécurité globale" est une atteinte non seulement au peuple violenté, mais aussi à la dignité même de la fonction de policier, qui ne devrait pas avoir besoin de ce genre de recours anticipé pour garantir à l’infini son impunité. Personne n’accuse la police dans son ensemble. Ce qui cristallise aujourd’hui la colère, ce sont non seulement les directives qui leur sont envoyées, mais aussi le fait que ces dernières encouragent les agissements violents, voire meurtriers.
Nous demandons à l’État de respecter son peuple et de se rappeler au droit humain le plus basique. Celui de ne pas mourir et de ne pas être violenté sans raison. Et si tel était le cas, qu'une défense existe.
- Social
- SRF
Communiqué de presse
Le 29 mars 2021
Bertrand Tavernier, « the quiet man »
« … et comme physiquement, il était plutôt intimidant avec cet œil unique qui paraissait vous regarder à l’intérieur de vous-même… » (B.T., sur John Ford)
C’est avec une grande tristesse que la SRF a appris la disparition de Bertrand Tavernier.
Il représentait une figure chère pour nous, celle du cinéaste-grand cinéphile dont on ne sait pas si l’idée qui préside à la création des films est d'abord une idée de cinéma ou une idée de sujet - et en ces temps où la tyrannie du « sujet » semble terrasser tous les projets qui ne reposent que sur « les chevilles cristallines de l’art » (Proust), c’est précieux.
Il fut un cinéaste aux deux chevilles donc, ou plutôt aux deux jambes, l’une française, l’autre américaine. Être un cinéaste français, c’est s’attaquer aux sujets propres à son pays, ancrés dans une topographie provinciale précise (Lyon pour L’Horloger de Saint-Paul), dans une sociologie stylisée par la série B (L’Appât), ressortissant à la manière panthéiste du patron Renoir (Un dimanche à la campagne) ou à des noeuds ténébreux de la grande Histoire (Capitaine Conan, La Vie et rien d’autre). C’est aussi s’attacher à des acteurs « typiques » (Philippe Noiret et ses manières matoises, Sabine Azéma abeille piquante et dame cinglante).
Le goût des grands sujets nationaux s’accompagnait chez lui d’une promotion, a contrario, des « marginaux » de la culture étrangère chez qui se logent violence, rébellion ou art oublié : adapter Jim Thompson (Coup de torchon), filmer le jazz comme une musique définitivement anti establishment (Autour de Minuit), ou encore reprendre en un geste purement amoureux le projet d’un cinéaste oublié (La Fille de D’Artagnan et Riccardo Freda). Films très français et cinéphilie pourtant très américaine, un faux paradoxe que les cinéphiles des générations cinquante et soixante surent résoudre et dont il est l’un des derniers représentants.
« … Je ne revois pas mes films. En fait, j’aime mieux me pencher sur le passé des autres que sur le mien. Et regarder l’avenir : alors, mes doutes se dissipent. » Du très précieux Dictionnaire du cinéma américain où le pointillisme des analyses s’accompagne d’une étonnante souplesse des goûts (ainsi le fameux et unique exercice de « réévaluation » d’une oeuvre) au magnifique Amis Américains, son œuvre de critique de cinéma maintenue active alors même qu’il était devenu cinéaste révèle que faire des films, c’est peut-être juste un fabuleux prétexte pour rendre hommage à ceux que l’on a passionnément aimés – comme un dialogue secret entre metteurs en scène.
Humilité et obsession du cinéaste-cinéphile : pensons au comte de Chabannes (Lambert Wilson) dans La Princesse de Montpensier qui, en retrait derrière les jeunes premiers bondissants de l’histoire avides de gloire facile, sut gagner l’estime de la princesse par sa fidélité et sa réserve.
La SRF
Contact presse : Rosalie Brun /rbrun@la-srf.fr/ 01.44.89.62.58
Cette tribune initiée par le groupe documentaire de la Société des réalisateurs de films (SRF) est signée par plus de 500 professionnels du cinéma parmi lesquels Julie Bertuccelli, Simone Bitton, Lucie Borleteau, Jean-Stéphane Bron, Dominique Cabrera, Jean-Louis Comolli, Catherine Corsini, Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, François Farellacci, Emmanuel Gras, Patricio Guzmán, Yves Jeuland, Wiliam Karel, Sébastien Lifshitz, Gérard Mordillat, Valérie Osouf, Rithy Panh, Nicolas Philibert, Jérôme Prieur, Abderrahmane Sissako, Claire Simon, Eyal Sivan, Yolande Zauberman ...
Réconcilions la télévision et le documentaire !
Le regard singulier que les documentaristes portent sur le monde a peu à peu disparu des écrans de télévision au profit de programmes à caractère journalistique. Si bien que ce que l’on appelle aujourd’hui « documentaire » à la télévision s’est progressivement écarté de toute filiation avec le cinéma.
Nous, réalisatrices et réalisateurs de films documentaires, constatons que les chaînes de télévision publique n’accordent quasiment plus aucune place au point de vue de l’auteur. Celles-ci ne cherchent plus à révéler ni œuvres, ni subjectivités, leur privilégiant une normalisation des formes et des récits. Nous déplorons d'être acculés à réaliser des contenus formatés au commentaire explicatif. Nous désapprouvons d’être dans l’obligation de scénariser à l'avance nos projets alors que, plus encore que dans les autres genres cinématographiques, un documentaire s'écrit au présent. Nous refusons de réduire notre perception sensible du monde à des « sujets ». Nous allons à la rencontre du réel pour que ce réel nous change, pour que se transforme l'idée que l'on pouvait s'en faire avant de le filmer.
En dehors de quelques cinéastes reconnus et de rares niches télévisuelles de résistance, notre désir de création n’est plus respecté. Nous n'avons plus la latitude d'expérimenter ni de travailler sur un temps long comme l’exigent les repérages, le tournage et le montage de nos films, alors qu'un film s'écrit à chacune de ces étapes. Nous n'avons plus la possibilité de réaliser des œuvres libres et singulières. Nous n'arrivons plus à exercer correctement notre métier.
Certes, il existe encore quelques espaces de diffusion pour le cinéma documentaire : 25 nuances de doc sur France 2, L’Heure D sur France 3, La Lucarne et le Grand Format sur Arte. Mais ces cases sont programmées à des heures tardives. Et surtout, elles sont rares : L’Heure D n’est diffusée que l'été, La Lucarne ne pré-achète au grand maximum qu'une demi-douzaine de films français par an et le Grand format d'Arte, 5. En 2021, ces objectifs déjà dérisoires seront réduits de moitié en conséquence de la pandémie. Les chaînes Public Sénat et LCP coproduisent elles-aussi quelques documentaires d’auteurs, mais leurs enveloppes budgétaires sont si faiblement dotées...
Quant au cinéma de patrimoine, quelle est la dernière fois que les téléspectateur.trice.s ont pu voir un film de Johan Van der Keuken, de Frederick Wiseman ou de Dziga Vertov ?
En 1987, un label « documentaire de création » avait été mis en place pour caractériser le travail des auteur.trice.s. La Commission Nationale de la Communication et des Libertés (CNCL, ancêtre du CSA) le définit alors comme un film « qui se réfère au réel, le transforme par le regard original de son auteur et témoigne d’un esprit d’innovation dans sa conception, sa réalisation et son écriture. Il se distingue du reportage par la maturation du sujet traité et la réflexion approfondie, la forte empreinte de la personnalité d’un réalisateur et (ou) d’un auteur ».
À l’heure où le débat public est polarisé, où la joute verbale et le buzz l’emportent sur l’analyse, nous pensons que le cinéma documentaire a toute sa place à la télévision. Le public partage ce souhait, comme l'attestent l’engouement pour le documentaire sur les plateformes qui lui sont dédiées, ainsi que les nombreux spectateurs adeptes des festivals. Le Cinéma du réel qui s'ouvre à Paris le 12 mars en est un exemple significatif.
En effet, quel genre artistique plus pertinent pour saisir le réel dans sa complexité ? Et quel vecteur plus adéquat que la télévision pour ouvrir ces espaces de réflexion critique et d'émotion esthétique au plus grand nombre ? Dans la période inédite que nous traversons, ce besoin nous paraît plus criant que jamais.
Aujourd’hui, nous demandons la réactivation d’un label pour le film documentaire permettant de le distinguer de l'enquête, du magazine et du reportage, assorti d’engagements de pré-achats, de coproductions, d’achats et de diffusion sur les chaînes publiques.
Afin que l’art du documentaire retrouve une place de choix à la télévision, nous sollicitons un rendez-vous pour aborder ces différents chantiers, aux directions de programmes d’Arte et de France Télévisions, au CSA et au CNC, sous l’égide du ministère de la Culture.
Rien n’est vrai, tout est vivant
(Édouard Glissant)
Signataires :
Judith Abitbol, cinéaste
Sandra Ach, monteuse, réalisatrice
Brice Ahounou, anthropologue
Ali Akika, cinéaste
Fleur Albert, réalisatrice
Karin Albou, cinéaste
Florence Alexandre, attachée de presse
Cécile Allegra, réalisatrice
Julie Allione, directrice de casting et réalisatrice
Christine Almeida, auteure, réalisatrice
Siegrid Alnoy, réalisatrice
Guillaume André, auteur, réalisateur
Viviane Aquilli, productrice
Marc Aderghal, réalisateur
Stéphane Arnoux, cinéaste, écrivain
Laure Arto, mixeuse
Claire Atherton, monteuse
Matthieu Augustin, chef monteur
Serge Avédikian, auteur, réalisateur, comédien
Nurith Aviv, cinéaste
Olivier Babinet, cinéaste
Sophie Bachelier, réalisatrice
Sandrine Bagarry, réalisatrice
Éloïse Baille, réalisatrice
Philippe Baillon, monteur
Gertrude Baillot, réalisatrice, chef opératrice
Sylvie Ballyot, cinéaste
Francois Barat, cinéaste, écrivain
Michel Barbizet, start-up co-founder
Matthieu Bareyre, réalisateur
Claude Barras, réalisateur
Antoine Barraud, cinéaste
Vincent Barthe, producteur, auteur
Barbara Bascou, monteuse
Joseph Beauregard, réalisateur
Nathalie Bély, responsable de la production audiovisuelle des expositions Mucem
Yohana Benattar, réalisatrice
Rahma Benhamou El Madani, réalisatrice
Martin Benoit, réalisateur
Sylvain Bergère, réalisateur
Jean-Marc Berlière, historien
Frédéric Bernard, réalisateur
Nina Bernfeld, cheffe opératrice
Matthieu Berthon, distributeur
Julie Bertuccelli, cinéaste
Thomas Bidegain, réalisateur, scénariste
Emanuelle Bidou, réalisatrice, formatrice cinéma
Simone Bitton, réalisatrice
Catherine Bizen, déléguée générale de Cinéma du réel
Manuelle Blanc, réalisatrice
Bernard Blancan, acteur-réalisateur
Sophie Blondy, cinéaste
Robert Bober, réalisateur
Cécile Bodénès, chef opératrice
Pascale Bodet, réalisatrice
Marie Bonnel, présidente des Ateliers Varan
Jean-Baptiste Bonnet, producteur, réalisateur
Corinne Bopp, programmatrice
Claudine Bories, réalisatrice
Lucie Borleteau, réalisatrice
Laurent Bouhnik, réalisateur
Jean-Philippe Bouyer, chef opérateur
Diane-Sara Bouzgarrou, auteure, réalisatrice
Guillaume Brac, réalisateur
Sophie Bredier, réalisatrice
Muriel Breton, réalisatrice, monteuse
Chantal Briet, réalisatrice
Laurence Briot, Forum des Images
Jean-Stéphane Bron, réalisateur
Chloé Bruhat, photographe
Dorine Brun, réalisatrice
Mikael Buch, réalisateur
Doris Buttignol, auteure, réalisatrice
Dominique Cabrera, cinéaste
François Caillat, réalisateur
Éric Caravaca, acteur, réalisateur
Lucie Cariès, réalisatrice
Pierre Carles, réalisateur
Capucine Caro, réalisatrice
Laetitia Carton, réalisatrice
Charles Castella, cinéaste
Patrice Chagnard, réalisateur
Etienne Chaillou, réalisateur
Adrien Charmot, réalisateur
Matthieu Chatellier, réalisateur
Marianne Chaud, réalisatrice
Luc Chessel, critique
Laurent Chevallier, réalisateur
Malik Chibane, réalisateur
Patric Chiha, réalisateur
Claire Childeric, cinéaste
Claire Chognot, réalisatrice
Dominique Choisy, réalisateur
François-Pierre Clavel, producteur et coprésident de l’association PEÑA
Daniel Cling, réalisateur, co-président de Périphérie
Romain Cogitore, réalisateur
Christophe Cognet, réalisateur
Jean-Luc Cohen, réalisateur
Vincent Cointet (de), auteur, réalisateur
Jérôme Colin, chef opérateur, réalisateur
Jean-Louis Comolli, réalisateur
Iñès Compan, réalisatrice,
Marine Contes (de), réalisatrice
Richard Copans, producteur, réalisateur
Christophe Cordier, documentariste
Catherine Corsini, réalisatrice
Philippe Costantini, cinéaste, membre fondateur des Ateliers Varan
Paul Costes, réalisateur
Olivier Cousin, réalisateur
Christophe Coutens, auteur, réalisateur
Jeanne Crépeau, cinéaste, formatrice
Jean-Noël Cristiani, réalisateur
Jean-Jacques Cunnac, auteur, réalisateur
Michel Daëron, cinéaste
Erik Damiano, réalisateur
Sylvaine Dampierre, réalisatrice
Marc Daquin, chef monteur
Elise Darblay, auteure, réalisatrice
Luc Dardenne, réalisateur
Jean-Pierre Dardenne, cinéaste
Isabelle Dario, réalisatrice, monteuse documentaire
Sonia Dayan-Herzbrun, philosophe, sociologue
Daniela De Felice, réalisatrice
Violette de l'Isle Adam, auteure-réalisatrice
Marina Déak, réalisatrice
Patrice Deboosère, auteur, réalisateur
Benjamin Delattre, auteur
Benoît Delbove, réalisateur, monteur
Alain Della Negra, réalisateur
Sophie Delvallée, autrice réalisatrice
Stéphanie Deniel, monteuse
Caroline Deruas, réalisatrice
Benoit Dervaux, chef opérateur
Arnaud Des Pallières, cinéaste
Jacques Deschamps, réalisateur
Daniel Deshays, créateur sonore
Hélène Desplanques, auteure, réalisatrice
Marion Desseigne Ravel, scénariste, réalisatrice
Matthieu Dibelius, cinéaste
Vincent Dieutre, cinéaste
Philippe Dinh, réalisateur, scénariste
Estelle Djana Schmidt, auteure, réalisatrice
Marie Dolez, documentariste
Ariane Doublet, réalisatrice
Judith Du Pasquier, réalisatrice
Émérance Dubas, réalisatrice
David Dufresne, réalisateur
Cédric Dupire, réalisateur
Pierre-Nicolas Durand, réalisateur
Jean Pierre Duret, réalisateur
Nadia El Fani, réalisatrice
Clara Elalouf, cinéaste
Philippe Elusse, distributeur
Licia Eminenti, scénariste, réalisatrice
Anais Enshaian, monteuse, réalisatrice
Amalia Escriva, réalisatrice
Abbas Fahdel, cinéaste
Anne Faisandier, réalisatrice
Hicham Falah, cinéaste, programmateur et directeur de Festivals
François Farellacci, réalisateur
Joël Farges, réalisateur
Laura Farrenq, réalisatrice
Frédéric Farrucci, réalisateur
Zouhair Fartahi, réalisateur
Frédéric Féraud, producteur
Hassen Ferhani, réalisateur
Maud Ferrari, auteure, réalisatrice
Anaïs Feuillette documentariste
Jérôme Fiévet, auteur, réalisateur
Emmanuel Finkiel, cinéaste
Dominique Fischbach, auteure, réalisatrice
Aline Fischer, autrice, réalisatrice
Michel Follin, réalisateur
Lena Fraenkel, productrice
Geneviève Fraisse, philosophe CNRS
Marine Francen, réalisatrice
Christine François, réalisatrice
Anne-Laure Franssu (de), réalisatrice
Denis Freyd, producteur
Damien Fritsch, auteur, réalisateur
Jean-Michel Frodon, critique
Sylvie Gadmer, chef monteuse, réalisatrice
Michelle Gales, réalisatrice
Anne Galland, réalisatrice
Jean-Luc Galvan, réalisateur
Valérie Ganne, autrice
Yves Gaonac’h, réalisateur
Thierry Garrel, ancien directeur de l'unité documentaire d'Arte
Etienne Gauthier, compositeur
Xavier Gauvillé, co-gérant d'Iskra
Laurence Gavron, cinéaste
Dyana Gaye, réalisatrice
Lizi Gelber, chef monteuse
Martin Genty, auteur, réalisateur
Sylvain George, cinéaste
Sophie Gergaud, auteure, programmatrice
Marion Gervais, réalisatrice
Sylvia Ghibaudo, documentariste
Bernard Ghilodes, scénariste, réalisateur
Anne Giafferi (de), réalisatrice
Pierre-Henri Gibert, réalisateur
Raphaël Girardot, cinéaste
Nathalie Giraud, réalisatrice documentaire
Christian Girier, réalisateur, chef-monteur
Arnaud Gobin, auteur, réalisateur
Pierre Goetschel, auteur, réalisateur
Frédéric Goldbronn, cinéaste
Arnaud Gonnet, réalisateur
Gabriel Gonnet, réalisateur
Audrey Gordon, réalisatrice
Catherine Gouze, monteuse
Diego Governatori, réalisateur
Emmanuel Gras, réalisateur
Monika Grassl, réalisatrice
David Grondin, auteur, réalisateur
Joanna Grudzinska, auteure, réalisatrice
Robert Guediguian, cinéaste
Lionel Guedj, réalisateur, producteur
João Rui Guerra da Mata, cinéaste (Portugal)
Valérie Guillaudot, réalisatrice
Eric Guirado, réalisateur, scénariste
Mariette Gutherz, réalisatrice
Patricio Guzman, cinéaste
Leila Habchi, auteure, réalisatrice de documentaires
Janette Habel, universitaire, politologue
Erika Haglund, réalisatrice
Rachid Hami, réalisateur
Nadja Harek, réalisatrice
Laurent Hasse, auteur, réalisateur
Eric Hazan, éditeur, écrivain
Aubin Hellot, auteur, réalisateur, producteur
Henri Herré, réalisateur
Tiago Hespanha, réalisateur, producteur
Alexandre Hilaire, réalisateur
Esther Hoffenberg, réalisatrice
Aline Holcman, cinéaste documentariste
Robin Hunzinger, cinéaste
David Hurst, producteur et coprésident de l’association PEÑA
Nancy Huston, écrivaine
Isabelle Ingold, réalisatrice
Sara Jabbar-Allen, photographe
Danielle Jaeggi, cinéaste
Agnès Jahier, directrice de Périphérie
Nicolas Jallot, réalisateur
Patric Jean, auteur, réalisateur
Audrey Jean-Baptiste, réalisatrice
Thomas Jenkoe, réalisateur
Patrick Jeudy, réalisateur
Yves Jeuland, réalisateur
Gaelle Jones, productrice
Elisabeth Jonniaux, auteure, réalisatrice
Bruno Joucia, réalisateur
Chrystel Jubien, réalisatrice
Carole-Anne Junchat, comédienne
Naruna Kaplan de Macedo, cinéaste membre de l’Acid
Elisabeth Kapnist, réalisatrice
Michel Kaptur, réalisateur
Wiliam Karel, réalisateur
Alain Kasanda, réalisateur
Vergine Keaton, réalisatrice
Rahmatou Keita, réalisatrice
Judit Kele, réalisatrice
Anna-Célia Kendall, réalisatrice
Djamel Kerkar, réalisateur
Raymond Kevorkian, historien
Michel Khleifi, cinéaste
Caroline Kim-Morange, réalisatrice
Laurence Kirsch, auteur, réalisatrice
Nino Kirtadzé, cinéaste
Nicolas Klotz, cinéaste
Adriana Komives, réalisatrice
Béatrice Kordon, réalisatrice
Julia Kowalski, réalisatrice
Jasna Krajinovic, réalisatrice
Rachel Krief, réalisatrice et scénariste
Daniel Kupferstein, réalisateur
Claire Laborey, réalisatrice
Xavier Ladjointe, cinéaste
Matthieu de Laborde, producteur
Léo Lagrafeuille, réalisateur
Christian Lajoumard, réalisateur, producteur
Thomas Lallier, réalisateur, directeur de la photographie
Arnaud Lambert, réalisateur
Alexandre Lança, réalisateur
Didier Lannoy, auteur, réalisateur
Daisy Lamothe, cinéaste
Marion Lary, cinéaste
Laurie Lassalle, réalisatrice
Jean Lassave, cinéaste, documentariste
Cécile Lateule, cinéaste
Sébastien Laudenbach, réalisateur
Julia Laurenceau, réalisatrice
Olivier Laurent, monteur son
Frédérick Laurent, scénariste et réalisateur
Quentin Laurent, producteur
Emmanuel Le Ber, réalisateur
Erwan Le Duc, réalisateur
Cyril Le Grix, auteur, réalisateur
Aurore Le Mat, réalisatrice
Serge Le Peron, réalisateur
Pierre-François Lebrun, réalisateur
Julien Lecat, réalisateur
Luc Leclerc du Sablon, réalisateur
Carole Leeman, productrice
Nicolas Lemée, auteur, technicien en documentaire et animation
Louise Lemoine Torres, actrice, autrice
Quentin Lestienne, réalisateur
Elisabeth Leuvrey, réalisatrice
Mosco Levi Boucault, cinéaste
Jean-Gabriel Leynaud, réalisateur et chef opérateur
Laurent Lhermite, cinéaste
Sébastien Lifshitz, cinéaste
Philippe Lignières, cinéaste
Sylvie Lindeperg, historienne, professeure des universités, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France
Marie Liotard, monteuse
Christophe Loizillon, réalisateur
Tessa Louise-Salomé, réalisatrice
Seloua Luste-Boulbina, philosophe
Benoit Maestre, réalisateur
Marie Maffre, réalisatrice
Olivier Magis, réalisateur
Sophie Mandonnet, chef monteuse de films
Marie Mandy, réalisatrice
Bernard Mangiante, réalisateur
Nathalie Mansoux, réalisatrice
Aurélien Manya, chef monteur
Nathalie Marcault, réalisatrice
Eva Markovits, critique
Claudia Marschal, réalisatrice
Philip Martin Lacroix, réalisateur
Alexandra Masbou, autrice, réalisatrice
Valérie Massadian, cinéaste
Guillaume Massart, réalisateur et producteur
Patricia Mazuy, réalisatrice
Hind Meddeb, cinéaste
Nadia Meflah, auteure, chargée de programmation
Angela Melitopoulos, artiste, cinéaste
Alexandra Mélot, productrice
Erik Menard, ingénieur du son
Kristell Menez, auteure, réalisatrice
Alois Menu Bernardet, acteur, réalisateur
Benjamin Mercui, producteur
Stéphane Mercurio, réalisatrice
Agnès Merlet, réalisatrice
Bernadette Mermier, cinéaste
Frederic Mermoud, réalisateur
Nicolas Mesdom, réalisateur
Jean-Henri Meunier, réalisateur
Julien Meunier, réalisateur
Muriel Meynard, productrice
Hélène Meynaud, sociologue
Arnaud de Mezamat, cinéaste, producteur, président du site film-documentaire.fr
Perrine Michel, réalisatrice
Thierry Michel, réalisateur
Eugénie Michel-Villette, productrice
Mathilde Mignon, réalisatrice
Laetitia Mikles, réalisatrice
Hélène Milano, cinéaste
Jonathan Millet, réalisateur
Edouard Mills-Affif, réalisateur
Jacques Mitsch, réalisateur
Frédéric Mitterrand, ancien ministre
Rodolphe Molla, monteur
Marielle Monpierre, réalisatrice
Gérard Mordillat, cinéaste, écrivain
Isabelle Moreau, exploitante
Laëtitia Moreau, réalisatrice, autrice
Roland Moreau, réalisateur, monteur, enseignant
Olivier Morel, professeur université USA
Manuela Morgaine, cinéaste
Anne Morin, réalisatrice
Emmanuelle Mougne, réalisatrice
Lucas Mouzas, auteur, réalisateur
Bruno Nahon, producteur
Nadine Naous, réalisatrice
Jean-François Naud, réalisateur
Fred Nicolas, auteur, réalisateur
Hervé Nisic, réalisateur
Joëlle Novic, réalisatrice
Anna Novion, réalisatrice
Orwa Nyrabia, directeur de l’IDFA
Raphaël O’Byrne, opérateur, réalisateur
Agathe Oléron, réalisatrice
Elsa Oliarj-Ines, réalisatrice
Valérie Osouf, réalisatrice
F. J. Ossang, écrivain, réalisateur
Mariana Otero, cinéaste
Bénédicte Pagnot, réalisatrice
Rithy Panh, cinéaste
Sonia Paramo, productrice
Dominique Pâris, monteuse
Denis Parrot, réalisateur
Anne Paschetta, auteur de documentaires pour le cinéma et la télévision
Jeanne Paturle, réalisatrice de documentaires animés
Marc Pavaux, réalisateur
Elisabeth Perceval, cinéaste
Viviane Perelmuter, réalisatrice
Yves Peretti (de), réalisateur
Anita Perez, chef monteuse
Renaud Personnaz, directeur de la photographie
Laurence Petit-Jouvet, réalisatrice
Monique Peyriere, historienne du cinéma documentaire (IIAC-LACI/ EHESS-CNRS)
Nicolas Philibert, réalisateur
Jean-Yves Philippe, réalisateur
Nora Philippe, réalisatrice
Raphaël Pillosio, producteur, coprésident de l’association PEÑA
Lila Pinell, réalisatrice
Sylvain Pioutaz, réalisateur
Christine Pireaux, autrice, productrice
Priscilla Pizzato, réalisatrice
Marine Place, auteure, réalisatrice
Béatrice Plumet, réalisatrice
Amalric Pontcharra (de), producteur
Gilles Porte, cinéaste
Christophe Postic, directeur artistique des États généraux du film documentaire de Lussas
Laure Pradal, réalisatrice
Sylvie Pras, responsable des Cinémas du Centre Pompidou
Franssou Prenant, cinéaste
Frédérique Pressmann, réalisatrice
Jérôme Prieur, réalisateur
Pierre Primetens, réalisateur
Olga Prud’homme Farges, réalisatrice, productrice
Olivier Raffet, directeur de la photographie
Frédéric Ramade, réalisateur
Jean-Jacques Rault, réalisateur
Isabelle Razavet, directrice de la photographie
Dominique Regueme, auteurs et réalisateurs
Jérémie Reichenbach, réalisateur
Franck Renaud, auteur-réalisateur
Marion Rey, chef-opératrice
Aurélie Ricard, monteuse
Chantal Richard, réalisatrice
Léo Richard, réalisateur et monteur
Hélène Ricome, réalisatrice
Nicolas Rincon Gille, réalisateur
Amanda Robles, responsable pédagogique de la Formation Alternée de l'ENSAV
João Pedro Rodrigues, cinéaste
Jane Roger, distributrice
Camille Rolin, productrice
Françoise Romand, cinéaste
Axelle Ropert, réalisatrice
François Rosolato, réalisateur
Laurent Roth, réalisateur
Christian Rouaud, réalisateur
Chantal Roussel, ancienne administratrice et membre des Ateliers Varan
Anna Roussillon, réalisatrice
Jean-Michel Roux, scénariste et réalisateur
Céline Rouzet, réalisatrice
Emmanuel Roy, réalisateur
Baptiste Saint-Dizier, monteur
Thomas Salvador, réalisateur
Pierre Salvadori, réalisateur
Julien Samani, cinéaste
Rima Samman, cinéaste, artiste
Jean Samouillan, scénariste, réalisateur
Gilles Sandoz, producteur
Andrea Santa, réalisatrice
Régis Sauder, réalisateur
Gabrielle Schaff, réalisatrice
Abraham Ségal, cinéaste
Ina Seghezzi, réalisatrice
Benjamin Serero, réalisateur
Reza Serkanian, cinéaste
Louis-Albert Serrut, auteur, réalisateur
Inger Servolin, gérante d'Iskra
Julie Siboni, réalisatrice
Charlotte Silvera, auteure, réalisatrice, productrice
Claire Simon, réalisatrice
Abderrahmane Sissako, cinéaste
Eyal Sivan, réalisateur
Peter Snowdon, réalisateur
Alexandra Sollogoub, autreure, réalisatrice
Vincent Sorrel, réalisateur
Michèle Soulignac, productrice
Anne Souriau, monteuse
Roger Souza, acteur, réalisateur
Heiny Srour, scénariste, réalisatrice, productrice
Ania Szczepanska, enseignante, chercheuse, réalisatrice
Jean-Marie Teno, réalisateur
Lidia Terki, cinéaste
Sabine Ternon, auteure, réalisatrice, monteuse
Mathias Théry, réalisateur
Serge Tigneres, réalisateur, scénariste, écrivain
Catherine Tissier, réalisatrice
Eliane de la Tour, cinéaste
Charlotte Tourrès, monteuse
François Tourtet, monteur, réalisateur
Marie-Claude Treilhou, cinéaste
Julien Triger, réalisateur
Gilles Trinques, cinéaste
Dominique Tripier-Mondancin, réalisateur, chef OPV
Elodie Trouvé, réalisatrice
Philippe Troyon, directeur adjoint de Périphérie
Dimitri Tuban, gérant de Pole Production
Jacky Tujague, réalisateur
Laetitia Tura, réalisatrice
Lydie Turco, autrice, réalisatrice
Gabriel Turkieh, auteur, producteur
Anja Unger, réalisatrice
Valérie Urréa, réalisatrice
André Van In, cinéaste, membre des Ateliers Varan
Valentine Varela, réalisatrice
Isabelle Vayron, auteure, réalisatrice
Paula Vélez Bravo, réalisatrice
Cédric Venail, auteur-réalisateur
Florent Verdet, réalisateur, producteur
Martin Verdet, réalisateur
François Vergès, historienne
Virginie Véricourt, monteuse, réalisatrice
Laure Vermeersch, cinéaste, administratrice L’ACID
Marie Vermillard, cinéaste
Marie Vernalde, auteure - réalisatrice
Béatrice Vernhes, réalisatrice
Aurélien Vernhes-Lermusiaux, réalisateur
Arnaud Viard, réalisateur
Ludovic Vieuille, réalisateur
Vanina Vignal, réalisatrice
Catalina Villar, réalisatrice
Emmanuelle Villard, réalisatrice
Maxence Voiseux, réalisateur
Alice Voisin, scénariste, réalisatrice
Colia Vranici, réalisatrice
Nicolas Wadimoff, réalisateur
Denis Walgenwitz, cinéaste
Juliette Warlop, scénariste documentaire
Éléonore Weber, réalisatrice
Annette Wieviorka, historienne
Anne-Catherine Witt, productrice
Zoé Wittock, réalisatrice
Olivier Wlodarczyk, producteur
Carole Wrona, écrivaine
Josiane Zardoya, monteuse
Yolande Zauberman, cinéaste
Caroline Zéau, co-présidente de Périphérie
Anouk Zivy, monteuse
Patrick Zocco, acteur, réalisateur
Organisations :
AARSE - Association des Auteurs Réalisateurs du Sud-Est
ACID - Association du cinéma indépendant pour sa diffusion
Addoc - Association des cinéastes documentaristes
Cinéastes non alignées
Documentaire sur grand écran
Etats généraux du documentaire - Lussas
Iskra
L'ARBRE - Association des Auteurs Réalisateurs en Bretagne,
L'ARNO - association Auteur.e.s Réalisateur.trice.s en Normandie
Les ateliers Varan
Le CRAC Collectif de réalisateurs – auteurs Corses
LMA - Les Monteurs associés
L’Union des Chefs Opérateurs
PEÑA - Produire en Nouvelle Aquitaine
Périphérie
SFR-CGT - Syndicat français des réalisateurs CGT
Cette tribune initiée par la Société des réalisateurs de films (SRF) et parue aujourd'hui dans Le Monde est signée par près de 50 organisations et plus de 800 professionnels du cinéma parmi lesquels Yvan Attal, Jacques Audiard, Antoine Barraud, Bertrand Bonello, Louise Bourgoin, Guillaume Canet, Laurent Cantet, Marion Cotillard, Anaïs Demoustier, Claire Denis, Sylvain Desclous, Valérie Donzelli, Philippe Faucon, Julie Gayet, Cédric Klapisch, Laurent Lafitte, Noémie Lvovsky, Chiara Mastroianni, Emmanuel Mouret, Pierre Niney, Axelle Ropert, Jean-Paul Rouve, Jean-Paul Salomé, Léa Seydoux, Gaspard Ulliel, Aurélien Vernhes-Lermusiaux, Karin Viard …
UN JOUR SANS FIN
Qu'est-ce qu'on attend exactement ?
Aujourd'hui, et depuis de très longs mois, les 5 913 écrans des 2 046 cinémas de France sont maintenus fermés au nom d'un principe de précaution sanitaire pourtant contredit par un avis du Conseil scientifique du 26 octobre et par l'étude ComCor de l'Institut Pasteur du 10 décembre 2020.
Aujourd'hui nous pourrons donc, encore et toujours, faire la queue pour aller acheter des baskets ou une glace, nous entasser dans les supermarchés ou prendre le train, même bondé, mais nous ne pourrons pas aller au cinéma. Ni au théâtre. Et cela malgré la mise en place d'un protocole sanitaire des plus stricts et des plus fiables dès le premier jour du déconfinement.
Au gré des chiffres, des variants, des politiques d'image, d'annonce, de culpabilisation ou d'intimidation, nous avons le sentiment d'être éradiqués. Et alors quoi ? On reste fermé un an, deux ans ? Pour toujours ?
Monsieur le Président, nous voudrions préciser une chose que l'opinion publique ne sait pas, mais que, bien plus grave, vous ne semblez pas savoir non plus : le cauchemar que vit l'industrie du cinéma, ses travailleurs et travailleuses, n'est pas tant celui de l'année passée, certes extrêmement difficile, mais bel et bien celui des deux voire trois années à venir. Chaque semaine de fermeture ajoute à la catastrophe en marche.
C'est l'avenir d'une profession qui est hypothéqué, à mesure que les films terminés s'empilent chaque semaine sur les étagères des distributeurs. C'est le « tout plateforme » qui s'installe dans les habitudes et dévalorise nos ambitions et nos droits. C'est une filière industrielle économique forte de 340 000 emplois qui coule. C'est un monde de débats et d'idées qui s'appauvrit considérablement. Car le cinéma ne se préoccupe pas que du cinéma. Il se préoccupe de tout ce qui fait société, ouvre à la réflexion, à la discussion, amène la rencontre avec ce public qui nous manque à hurler. Et à qui l'on manque.
Quel gâchis.
Quelle violence.
Quelle injustice.
Combien de fois faudra-t-il répéter qu'aucun théâtre, lieu de culture ou salle de cinéma n'a été un cluster ? Combien de fois faudra-t-il répéter que nous ne sommes ni des troubadours égoïstes et déconnectés, ni des divas dans des tours d'ivoire mais bel et bien des femmes et des hommes responsables, conscients de la gravité de la situation ? Que le cinéma français est la troisième cinématographie la plus importante du monde, et que vous risquez de la faire s'effondrer en à peine un an.
Monsieur le Président, une étude allemande menée par l'Institut Hermann Rietschel (Université de Berlin) vient de conclure que les salles de cinéma sont deux fois plus sûres que les supermarchés et trois fois plus sûres que les voyages en train. Lisez-la !
Votre silence et celui de votre gouvernement sont en train de tuer le cinéma français, et plus généralement une grande partie de notre culture.
Dans le respect des gestes barrières, de la distanciation physique et d'une jauge qui permette à chacun d'être en sécurité : ré-ouvrez les salles ! Maintenant !
Signataires :
Margot Abascal, comédienne
Judith Abitbol, cinéaste
Jean Achache, réalisateur et producteur
Mona Achache, réalisatrice
Julie Aguttes, réalisatrice
Vicentia Aholoukpé, exploitant de salles
Fleur Albert, réalisatrice
Fulvia Alberti, réalisatrice
Karin Albou, scénariste, réalisatrice et écrivaine
José Alcala, scénariste et réalisateur
Florence Alexandre, attachée de presse
Inès Alez-Martin, accessoiriste plateau
Rémi Allier, réalisateur
Siegrid Alnoy, scénariste et réalisatrice
Noël Alpi, réalisateur
Oulaya Amamra, comédienne
Nathan Ambrosioni, réalisateur
Shirel Amitay, scénariste et réalisatrice
Viviani Andriani, attachée de presse
Claire Angelini, artiste et réalisatrice indépendante
Théodore Anglio-Longre, étudiant en master de cinéma et critique
Alix Anne, réalisatrice
Charlie Anson, acteur
Eric Altmayer, producteur
Nicolas Altmayer, producteur
Marie-France Alvarez, comédienne
Cristèle Alves Meira, réalisatrice
Patrick André, producteur
Christophe Andréi, scénariste et réalisateur
Hélène Angel, scénariste et réalisatrice
Stéphane Arnoux, réalisateur
Ariane Ascaride, actrice
Aure Atika, comédienne
Yvan Attal, comédien
Samuel Aubin, scénariste
Nicolas Aubry, réalisateur
Jacques Audiard, réalisateur
Jean Luc Audy, chef opérateur son
Axel Auriant, comédien
Serge Avedikian, comédien, auteur et réalisateur
Jocelyne Ayella, médecin
Myriam Aziza, réalisatrice
Anne Azoulay, comédienne et réalisatrice
Noé Bach, directeur de la photographie
Sébastien Bailly, réalisateur
Coralie Barelier, assistante chargée de figuration
Matthieu Bareyre, réalisateur
Olivier Baroux, réalisateur
Claude Barras, réalisateur et scénariste
Claire Barrau, auteure, productrice
Antoine Barraud, réalisateur
Vincent Barre, sculpteur et réalisateur
Patricia Barsanti, présidente de la société Cinématographique Lyre
Sophie Bataille, attachée de presse
Luc Battiston, réalisateur
Jean-Pierre Bastid, auteur, réalisateur
Pierre Baussaron, producteur
Mathilde Bayle, scénariste et réalisatrice
Florian Beaume, scénariste et réalisateur
Frank Beauvais, réalisateur
Xavier Beauvois, réalisateur
Pierre Beccu, auteur, réalisateur
Noémie Bédrède, programmatrice
Alice Belaidi, actrice
Raymond Bellour, directeur de recherche honoraire au CNRS, membre de la rédaction de Trafic, revue de cinéma
Lucas Belvaux, réalisateur
Kaouther Ben Hania, réalisatrice
Adila Bendimerad, actrice, productrice
Alain Benguigui, producteur
Arnaud Bénoliel, scénariste, réalisateur
Tanguy Bernard, musicien et réalisateur
Marc Bertin, comédien
Vanessa Bertin, assistante de production
Diane Bertrand, cinéaste
Fatima Bianchi, monteuse, réalisatrice
Thomas Bidegain, scénariste et réalisateur
Lisa Billuart-Monet, réalisatrice
Liouba Bischoff, enseignante-chercheuse
Sylvia Biville, comptable
Catherine Bizern, déléguée générale du Cinéma du Réel
Bernard Blancan, comédien et réalisateur
Christian Blanchet, cinéaste
Lise Blanchet, journaliste
Léo Blandino, auteur, réalisateur
Catherine Blangonnet-Auer, directrice de rédaction Images documentaires
Laurent Blois, délégué général du SPIAC
Sophie Blondy, réalisatrice
Thalie Boccabella, régisseuse
Philip Boëffard, producteur
Romane Bohringer, cinéaste
Maxime Boilon, membre de RegarDocc
Aurélie Boivin, réalisatrice et photographe
Nicolas Bole, coordinateur général de festival
Georges Bollon, retraité de l’action culturelle cinématographique
Mathieu Bompoint, producteur
Caroline Bonmarchand, productrice
Jérôme Bonnell, réalisateur
Bertrand Bonello, cinéaste
Valérie Bonneton, actrice
Aurélie Bordier, déléguée générale de l’ACID
Florence Borelly, productrice
Claudine Bories, réalisateur
Lucie Borleteau, réalisatrice
Gabriel de Bortoli, attaché de presse
Claude Bossion, réalisateur
Marie Bottois, monteuse
Odile Bouchet, membre actif de l’Association Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse ARCALT
Laurent Bouhnik, réalisateur
Lucie Boujenah, comédienne
Louise Bourgoin, actrice
Sophie Bouteiller, scripte, 1ère assistante réalisateur·ice
Karine Boutroy, architecte scénographe
Diane Sara Bouzgarrou, cinéaste
Leyla Bouzid, réalisatrice
Guillaume Brac, réalisateur
Sandrine Brauer, productrice
Guillaume Bréau, réalisateur et scénariste
Sophie Bredier, réalisatrice
Jean Bréhat, producteur
Jean Breschand, scénariste
Adrien Bretet, producteur
Eric-John Bretmel, réalisateur
Pascale Breton, réalisateur
Caroline Brésard, comédienne
Peter Brook, metteur en scène, acteur, réalisateur et écrivain
Marie Brugière, comédienne, metteuse en scène de théâtre
Dorine Brun, réalisatrice
Rosalie Brun, déléguée générale de la SRF
Damien Brunner, producteur
Didier Brunner, producteur
Claire Burger, réalisatrice
Gaël Cabouat, producteur
Arthur Cahn, auteur, réalisateur
Hubert Caillard, avocat
Thomas Cailley, réalisateur
Laure Calamy actrice
Chloé Cambournac, chef décoratrice
Géraldine Cance, attachée de presse
Guillaume Canet, acteur et réalisateur
Laurent Cantet, réalisateur
Marilyne Canto, comédienne
Christine Cardaropoli, chef maquilleuse, chef coiffeuse
Johanna Careire, directrice Artistique Festival International du Film Indépendant de Bordeaux
Patrice Carré, journaliste et réalisateur
Stéphane Carreras, productrice
Nyima Cartier, réalisatrice
Yannick Casanova, réalisateur
Catherine Castel, réalisatrice
Charles Castella, réalisateur
Anna Cazenave Cambet, réalisatrice
Emilie Cazenave, actrice
Sophie Chaffaut, attachée de presse
Patrice Chagnard, réalisateur
Etienne Chaillou, réalisateur
Emmanuel Chain, producteur
Marie-Sophie Chambon, scénariste-réalisatrice
Arié Chamouni, producteur
Céline Chapdaniel, productrice
Marie de Chassey, scripte
Chantal Chatelain, représentante de spectateurs
Olivier Charasson, acteur
Elsa Charbit, directrice artistique d’Entrevues festival international du Film de Belfort
Eric Charbot, producteur
Jérémie Charrier, attaché de presse
Hubert Charuel, réalisateur
Carole Chassaing, productrice
Remi Chaye, réalisateur
Sarah Chazelle, distributrice
Judith Chemla, actrice
André Chesneau, retraité
Catherine Chesnau, artiste peintre
Colin Chesneau, monteur
Camille Chevalier, secrétaire générale adjointe de la Quinzaine des réalisateurs
Emmanuel Chevalier, distributrice
Laurent Chevallier, réalisateur
Brigitte Chevet, réalisatrice
Louise Chevillotte, comédienne
Malik Chibane, réalisateur
Benoît Chieux, réalisateur
Patric Chiha, réalisateur
Maguy Cisterne, secrétaire générale du festival de Brive
Christine Citti, actrice, autrice
Hung-Chun Chen, réalisatrice
Nathalie Cheron, directrice de casting, Présidente de l’ARDA
Manuel Chiche, gérant The Jokers Films
Vanya Chokrollahi, réalisateur
Jean Paul Civeyrac, attaché de press
Jeremy Clapin, réalisateur
Marion Clauzel, scénariste
Marie Clément, enseignante en cinéma
Alexandre Coffre, réalisateur, scénariste
Clément Cogitore, réalisateur
Christophe Cognet, réalisateur
Abraham Cohen, réalisateur
Joachim Cohen, assistant d’agent artistique
Richard Copans, réalisateur et producteur
Louise Coldefy, actrice
Christine Colin Milko, adaptatrice doublage
Etienne Comar, réalisateur
Muriel Combeau, actrice
Jean-Louis Comolli, réalisateur et écrivain
Anne Consigny, comédienne
Thierry Consigny, publicitaire
Philippe Coquillaud-Coudreau, directeur du cinéma Le Méliès à Pau
Catherine Corsini, réalisatrice
Marion Cotillard, comédienne
Jean Cottin, producteur
Manon Coubia, réalisatrice
Bénédicte Couvreur, productrice
Vero Cratzborn, réalisatrice
Anne-Claire Créancier, directrice de production
Marc-Benoît Créancier, producteur
Jeanne Crépeau, réalisatrice et formatrice
Juliette Crété, 1ère Assistante mise en scène
Jean-Noël Cristiani, réalisateur
Romain Cros, premier assistant réalisateur
Laurent Crouzeix, délégué général du festival Sauve Qui peut le court métrage
Delphine Crozatier, présidente de Contrebande Productions
Johann Cuny, acteur
Jean-Jacques Cunnac, auteur-réalisateur
Isabelle Czajka, réalisatrice
Didier d’Abreu, cinéaste
Raphaëlle Danglard, agent artistique
Marie Daniel, directrice de l'IFFCAM
Benoit Danou, producteur
Danièle D’Antoni, agent artistique
Aurélie Dard, attachée de presse
Fleur Dagorn, étudiante en production audiovisuelle
Isabelle Dario, réalisatrice et monteuse
Joao Da Rocha, doctorant en littérature française
Judith Davis, réalisatrice et comédienne
Antoine de Bary, réalisateur
Marie de Busscher, réalisatrice
Albane de Jourdan, productrice
Marie Jade Debard, comédienne
Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste, professeur émérite à l'Université Paris Nanterre
Patrick Dekeyser, vidéaste
Isabelle Delbecq, cheffe décoratrice
Emilie Deleuze, réalisatrice
Sarah Delmas, directrice des développements
Natacha Delmon Casanova, productrice
Edouard Deluc, scénariste et réalisateur
Sophie Delvallée, réalisatrice
Emmanuelle Demoris, réalisatrice
Anaïs Demoustier, actrice
Arnaud Demuynck, réalisateur
Claire Denis, réalisatrice
Florence Denou, actrice
David Depesseville, réalisateur
Eugénie Deplus, directrice de post production
Pauline de Raymond, responsable de programmation à la Cinémathèque française
Arnaud des Pallières, réalisateur
Tom Dercourt, producteur
Julien Deris, producteur
Cécile Déroudille, réalisatrice
Caroline Deruas, réalisatrice
Guillaume Descamps, secrétaire général du Festival des Trois Continents
Sylvain Desclous, réalisateur
Christophe Desenclos, directeur de production
Daniel Deshays, ingénieur du son
Antoine Desrosieres, réalisateur
Alexandre Desrousseaux, acteur
Marion Desseigne Ravel, scénariste et réalisatrice
Emmanuelle Devos, actrice
Eric Devulder, chef opérateur du son
Marcial Di Fonzo Bo, acteur et directeur de la Comédie de Caen
Katell Djian, chef opérateur
Vanessa Djian, productrice
Didar Domehri, productrice
Timothée Donay, distributeur
Anthony Doncque, producteur
Valérie Donzelli, réalisatrice et actrice
Clément Dorival, réalisateur
Christine Dory, cinéaste
Laetitia Dosch, actrice
Alice Douard, réalisatrice
Claire Doyon, cinéaste
Céline Drean, scénariste et réalisatrice
Evelyne Dress, auteur, réalisateur et producteur
Léa Drucker, comédienne
Émérance Dubas, réalisatrice
Bernard Dubois, réalisateur
Claire Duburcq, actrice
Cécile Ducrocq, réalisatrice
David Dufresne, réalisateur
Marc Dugain, réalisateur
Pierre Dugowson, réalisateur
Hervé Duhamel, directeur de production cinéma
Sandrine Dumas, réalisatrice
Annick Dumout
Pierre-Nicolas Durand, réalisateur
Karine Durance, attachée de presse
Riton Dupire-Clément, chef décorateur
Claire Duburcq, actrice
Jean Pierre Duret, ingénieur du son
Léo Dussollier, acteur
Claude Duty, réalisateur
Chloé Duval, réalisatrice
Roland Edzard, réalisateur
Nadia El Fani, réalisatrice
Ismaël El Iraki, réalisateur
Kamal El Mahouti, réalisateur
Nicolas Elghozi, producteur
Philippe Elusse, auteur réalisateur
Jean-Bernard Emery, attaché de presse
Licia Eminenti, scénariste et réalisateur
Mareike Engelhardt, réalisatrice
Octavio Espirito Santo, directeur de la photographie
Laurine Estrade, réalisatrice
Audrey Estrougo, réalisatrice
Séréna Evely, travailleur indépendant dans le domaine culturel
Hicham Falah, cinéaste, délégué général du Festival International de film Documentaire à Agadir et Directeur artistique du Festival international du film de femmes de Salé
Jacques Fansten, réalisateur
François Farellacci, réalisateur
Coralie Fargeat, réalisatrice
Frédéric Farrucci, réalisateur
Philippe Faucon, réalisateur
Cyrielle Faure, réalisatrice
Julia Faure, comédienne
Pascale Faure, productrice
Léa Fehner, réalisatrice
Michel Feller, producteur
Cécile Felsenberg, agent artistique
Julien Féret, producteur et réalisateur
Ariza Fernando, directeur Festival Huelas
Maud Ferrari, scénariste et réalisatrice
Linda Ferrer Roca, réalisatrice
Jeanne Ferron, comédienne
Michel Ferry, réalisateur et exploitant de salles
Anaïs Feuillette, documentariste
Agnès Feuvre, scénariste
Francine Filatriau, chef opérateur, réalistrice
Emmanuel Finkiel, réalisateur
Aline Fischer, scénariste et réalisatrice
Chantal Fischer, productrice
Marie Fischer, 1ère assistante réalisateur
Stéphane Foenkinos, auteur et réalisateur
Victoria Follonier, monteuse
Fanny Fontan, scénariste et réalisatrice
Camille Fontaine, scénariste réalisatrice
Benoît Forgeard, réalisateur
Aurélie Fournier, professeur de lettres
Leila Fournier, responsable de distribution artistique
Eric Fourniols, scénariste, réalisateur
Tristan Francia, auteur, réalisateur
Christine François, réalisatrice
Samuel François-Steininger, producteur
Jacques Frétel, retraité
Brahim Freita, auteur et réalisateur
David Frenkel, producteur
Manuela Frésil, cinéaste
Damien Fritsch, réalisateur
François Fronty, réalisateur
Jones Gaëlle, productrice
Jean-Luc Gaget, scénariste
Luc Gallissaires, réalisateur
Antoine Garceau, réalisateur
Laurence Garret, cinéaste
Florence Gastaud, productrice
David Gauquié, producteur
Julie Gayet, réalisatrice
Cyril Gelblat, réalisateur
Hugo Gélin, réalisateur
Fabrice Genestal, réalisateur
Sylvain George, réalisateur
Anne Georget, réalisatrice, présidente du FIPADOC
Anne Gerles, coordinatrice de production
Hassam Ghancy, acteur
Denis Gheerbrant, réalisateur
David Gheron Tretiakoff, plasticien
Mariette Gutherz, réalisatrice
Pauline Gilbert, directrice de post-production
Yann Gilbert, producteur
Léa Gilet-Lorand, assistante casting
Bernard Gilhodes, scénariste, réalisateur et reporter
Claudie Gillot-Dumoutier, présidente de l’association Cinéma l’Écran à Saint-Denis
Thomas Gilou, scénariste et réalisateur
Alice Girard, productrice
Elise Girard, réalisatrice
Hippolyte Girardot, comédien
Jacques-Rémy Girerd, auteur et réalisateur
Félix de Givry, réalisateur
Delphine Gleize, réalisatrice
Lucas Gloppe, réalisateur
Fabrice Gobert, réalisateur
Fabrice Goldstein, producteur
Marion Gollety, déléguée cinéma du SPI
Tito González García, réalisateur
Yann Gonzalez, réalisateur
Florent Gouëlou, réalisateur
Diego Governatori, réalisateur
Christine Gozlan, productrice
Alexander Graeff, réalisateur
Laurence Granec, attachée de presse
Camille Grangé, scénariste
Denys Granier-Deferre, réalisateur
Emmanuel Gras, réalisateur
Alexandra Grau de Sola, réalisatrice, scénariste
Eugène Green, cinéaste et écrivain
Pascal Greggory, acteur
Audrey Grimaud, attachée de presse
Benjamin Groussain, steadicamer
David Grumbach, directeur général Bac Films
Samir Guesmi, acteur et réalisateur
Dominique Guerin, productrice
José Luis Guerin, réalisateur
Philippe Guilbert, directeur de la photographie
Olivier Guillaume, mixeur
Pierre Guyard, producteur
Patrick Hadjadj, réalisateur
Stéphanie Halfon, chargée de développement
Arthur Hallereau, directeur marketing
Virginie Hallot , comédienne, metteure en scène et scénariste
François Hamel, directeur de production
Rachid Hami, réalisateur
Violaine Harchin, distributrice
Ted Hardy-Carnac, réalisateur
Antoine Héberlé, directeur de la photographie
Arnaud Hemery, scénariste
Judith Henry, comédienne
Ludovic Henry, producteur, co-président du ROC
Laurent Herbiet, réalisateur et scénariste
Noël Herpe, réalisateur
Clotilde Hesme, actrice
Laurent Heynemann, réalisateur
Alexandre Hilaire, réalisateur
Mireille Hilsum, professeure émérite de l’Université Jean Moulin Lyon 3
Xavier Hirigoyen, directeur de la distribution
Esther Hoffenberg, réalisatrice et productrice
Julien Hosmalin, réalisateur
Armel Hostiou, cinéaste
Gabrielle Hours, directrice de production
Danielle Jaeggi, réalisatrice
Raphaël Jacoulot, réalisateur
Olivier Jahan, réalisateur
Catherine Jarrier, chef décoratrice
Diane Jassem, productrice
Audrey Jean-Baptiste, réalisatrice
Thomas Jeand’heur, comédien
François-Régis Jeanne, réalisateur
Thomas Jenkoe, réalisateur
Vanessa Jerrom, attachée de presse
Charlie Joirkin, comédienne
Gaëlle Jones, productrice
Thierry Jousse, réalisateur et producteur radio
Guillaume Juhel, directeur marketing
Valérie Jung, scénographe
Régine Jusserand, monteuse
Jean Kalman, créateur lumières
Daniel Kamwa, acteur et réalisateur
Leslie Kaplan, écrivain
Naruna Kaplan de Macedo, cinéaste membre de l'ACID
Sam Karmann, comédien, réalisateur
Sehrat Karaaslan, réalisateur
Valérie Karsenti, comédienne
Vergine Keaton, réalisatrice
Marc Khanne, réalisateur documentaire
Canelle Kieffer-Silou, directrice de production et post-production
Christine Kiehl, maître de conférences, directrice L3, département d'études du monde anglophone, département d'arts du spectacle, Université Lumière Lyon 2
Nadège Kintzinger, chef monteuse image
Laurence Kirsch, auteure et réalisatrice
Cédric Klapisch, réalisateur
Florent Klockenbring, opérateur du son
Manon Kneusé, comédienne
Beaudoin Koenig, réalisateur
Anne Lise Kontz, attachée de presse
Béatrice Kordon, réalisatrice
Corinne Kouper, productrice
Nathalie Kouper, coordinatrice générale du festival Paris Courts Devants
Julia Kowalski, réalisatrice
François Kraus, producteur
Rachel Krief, réalisatrice, scénariste
Jean Labadie, directeur général Le Pacte
Manele Labidi, réalisatrice
Pierre Lacan, réalisateur
Joris Lachaise, réalisateur
Madeleine Lacombe, retraitée, théâtre amateur
Vincent Lacoste, acteur
Didier Lacourt, distributeur Diaphana
Nathalie Lacroix, comédienne
Laurent Lafitte, acteur et réalisateur
Joachim Lafosse, réalisateur
Leslie Lagier, réalisatrice
Marion Laine, réalisatrice
Alexandre Lamarque A.F.C, directeur de la photographie
Marion Lambert, comédienne
Alexandre Lança, cinéaste, co-président du ROC
Kloé Lang, réalisatrice
Didier Lannoy, auteur réalisateur
Massoumeh Lahidji, interprète
Séverine Lajarrige, attachée de presse
Véronique Lalubie, réalisatrice
Élise Larnicol, actrice
Maria Larrea, réalisateur
Jean-Marie Larrieu, réalisateur
Kristina Larsen, productrice
Eric Lartiguau, réalisateur
Sonia Larue, réalisatrice
Marion Lary, réalisatrice
Laurence Lascary, productrice
Manu Laskar, acteur et cinéaste
Sarah Lasry, réalisatrice
Albertine Lastera, monteuse
Sébastien Laudenbach, réalisateur
Julie Leclerc, habilleuse
Luc Leclerc du Sablon,réalisateur
Lidia LeBer Terki, réalisatrice
Gabriel Le Bomin, réalisateur
William Lebghil, comédien
Anna Lebovits, comédienne
Julien Lecat, réalisateur
Michel Leclerc, scénariste, réalisateur
Quentin Lecocq, réalisateur
Erwan Le Duc, réalisateur
Murielle Lefebvre, comédienne
Michelle Le Gaffric, collaboratrice d’agent artistique
Cyril le Grix, réalisateur et metteur en scène
Jean-Baptiste L’Herron, agent artistique
Karolyne Leibovici, publicist de talents
Nolwenn Lemesle, scénariste et réalisatrice
Louise Lemoine Torrès, actrice et scénariste
Alban Lenoir, comédien
Blandine Lenoir, réalisatrice
Serge Le Péron, réalisateur
Grégoire Leprince-Ringuet, acteur, réalisateur
Etienne Lerbret, attaché de presse indépendant
Anthony Lesaffre, producteur
Quentin Lestienne, réalisateur
Florence Lesven, directrice de production
Guillaume Levil, scénariste et réalisateur
Elisabeth Leuvrey, réalisatrice
Karen Levy Bencheton, productrice
Lorraine Lévy, réalisatrice
Christelle Lheureux, scénariste, réalisatrice et enseignante
Philippe Liégeois, producteur
Philippe Lignières, cinéaste
Carl Lionnet, scénariste et réalisateur
Jean-Louis Livi, producteur
Philippe Locquet, réalisateur
Florence Loiret Caille, comédienne
Franco Lolli, réalisateur
Antoine Lopez, cofondateur du festival de Clermont-Ferrand
Chloé Lorenzi, attachée de presse
Marie Losier, réalisatrice et artiste
Emile Louis, assistant réalisateur
Olivier Loustau, réalisateur
Marie-Ange Luciani, productrice
Nicolas Lugli, réalisateur
Anne Luthaud, déléguée générale du GREC
Noémie Lvovsky, scénariste, réalisatrice et actrice
Jean Mach, producteur, réalisateur
Lisa Macheboeuf, scénariste
Gregory Magne, scénariste et réalisateur
Celia Mahistre, attachée de presse
Juliette Maillard, 1ère assistante réalisation
Pierre Maillet, acteur, metteur en scène
Gaëlle Malandrone, comédienne
Caroline Maleville, programmatrice
Yohan Manca, scénariste, réalisateur et acteur
Bertrand Mandico, réalisateur
Marie Mandy, réalisatrice
Damien Manivel, réalisateur
Naël Marandin, réalisateur
François Margolin, réalisateur et producteur
Zulmira Marquet, auto-entrepreneuse
Paul Marques Duarte, réalisateur
Juliette Martinaud, alternante juriste
Laila Marrakchi, réalisatrice
Corinne Masiero, comédienne
Marie Masmonteil, productrice
Babette Masson, directrice de compagnie de théâtre
Lucas Masson, réalisateur, monteur
Chiara Mastroianni, actrice
Claire Mathon, directrice de la photographie
Marie-Annick Mattioli, maîtresse de conférences en anglais
Edouard Mauriat, producteur
Nicolas Maury, réalisateur, acteur
Pierre Mazingarbe, réalisateur
Chloé Mazlo, réalisatrice
Mohamed Megdoul, réalisateur
Boris Mendza, producteur
Jean-Luc Mengus, correcteur et secrétaire de rédaction de la revue Tafic
Marie-Castille Mention-Schaar, scénariste, réalisatrice et productrice
Aloïs Menu Bernadet, acteur et réalisateur
Stéphane Mercurio, réalisateur
Agnès Merlet, réalisatrice
Vincent Merlin, directeur de Cinémas 93
Frédéric Mermoud, réalisateur
Nicolas Mesdom, réalisateur
Nina Meurisse, comédienne
Constance Meyer, réalisatrice
Mathilde Mignon, réalisatrice
Élise Mignot, directrice Café des Images
Radu Mihaileanu, réalisateur
Perrine Mihel, réalisatrice
Viktor Miletić, réalisateur
Emmanuelle Millet, réalisatrice
Céline Milliat Baumgartner, actrice
Félix Moati, acteur-réalisateur
Dominik Moll, réalisateur
Grégory Montel, comédien
Anne Monfort, metteuse en scène
Béatrice Moreno, auteure et productrice
Manuela Morgaine, réalisateur
Keren Moriano, productrice
Hélène Morsly, actrice et réalisatrice
Maxime Motte, réalisateur
Emmanuel Mouret, réalisateur
Florence Muller, comédienne
Véronique Müller, comédienne
Xavier Mussel, acteur, scénariste et réalisateur
Mathilde Muyard, chef monteuse
Louise Narboni, réalisatrice
Jean-Francois Naud, documentariste
Kim Nguyen, directrice de production
Fred Nicolas, scénariste et réalisateur
Loïc Nicoloff, scénariste, réalisateur
Nathan Nicolovitch, cinéaste
Pierre Niney, comédien
Sofia Norlin, réalisatrice
Valentina Novati, productrice et distributrice
Joëlle Novic, réalisatrice
Anna Novion, réalisatrice
Christophe Offenstein, réalisateur
Agathe Oléron, autrice, réalisatrice
Delphine Olivier, attachée de presse
Etienne Ollagnier, distributeur
Valérie Osouf, réalisatrice
Manon Ott, réalisatrice
Thomas Ordonneau, producteur
Damien Ounouri, réalisateur
Bénédicte Pagnot, réalisatrice
Géraldine Pailhas, actrice
Nalin Pan, auteur, réalisateur
Capucine Pantin, assistante de décoration
Marie-Christine Parcot, chargée de communication
Mélanie Parent-Chauveau, scripte
Daniel Paris, réalisateur et écrivain
Antoine Parouty, directeur de la photographie
Doriane Pasquale, comédienne et réalisatrice
Michel Patient, réalisateur
Héloïse Pelloquet, réalisatrice
Stéphanie Perard, comédienne
Antoine Pereniguez, gérant de Diagonal Cinémas à Montpellier
Antonin Peretjatko, réalisateur
Thomas Percy, attaché de presse
Alexandre Perez, auteur et réalisateur
Elisabeth Perez, productrice
Nahuel Perez Biscayart, acteur
Sandie Perez, directrice de casting
Léa Pernollet, scénariste
Julie Perreard, auteure, réalisatrice
Mireille Perrier, actrice
Bruno Pesery, producteur
Martin Peterolff, réalisateur
Philippe Petit, réalisateur
Sylvère Petit, réalisateur
Laurence Petit-Jouvet, réalisatrice
Benoît Pétré, réalisateur
Olivier Peyon, réalisateur
Nora Philippe, réalisatrice
Alexandra Pianelli, réalisatrice
Pierre Pinaud, réalisateur
Sylvain Pioutaz, réalisateur
Xavier Plèche, producteur
Sébastien Plessis, chef électricien
Caroline Poggi, réalisatrice
Marie Poitevin, réalisatrice
Morgan Pokée, programmateur Cinéma Le Concorde La Roche-sur-Yon et comité de sélection de la Quinzaine des Réalisateurs
Bénédicte Portal, scénariste
Fany Pouget, première assistante réalisation
Jean Baptiste Pouilloux, réalisateur
Romain Poujol, directeur marketing
Laure Pradal, réalisatrice
Joana Preiss, actrice et réalisatrice
Shalimar Preuss, réalisatrice
Vincent Prin
Mathilde Profit, réalisatrice
Anne-Marie Puga, réalisatrice
Jean-Philippe Puymartin, acteur, réalisateur, directeur artistique
Andréa Queralt, productrice
Marie Queysanne, attachée de presse
François Quiqueré, monteur
Olivier Rabourdin, acteur
Anastasia Rachman, distributrice
Alain Raoust, réalisateur
Emmanuel Alain-Raynal, producteur
Isabelle Rebre, cinéaste
Catherine Rechard, documentariste
Antoine Rein, producteur
Antoine Reinartz, comédien
Cécile Remy-Boutang, directrice de production
Cyrill Renaud, directeur de la photographie
Guillaume Renusson, réalisateur
Quentin Reynaud, réalisateur
Damien Riba, réalisateur, compositeur et producteur
Pascal Ribier, ingénieur du son
Xavier Rigault, producteur
André Rigaut, ingénieur du son
Vincent Rinaldi, assistant monteur
Stéphane Robelin, auteur, réalisateur
Marc-Antoine Robert, producteur
Mathieu Robin, scénariste et réalisateur
Séverine Rocaboy, exploitante de salles
Loïs Rocque, producteur
Giulia Rodino, monteuse
Dominique Roland, conseillère municipale
Axelle Ropert, réalisatrice
Claudia Rosenblatt, adaptatrice dans l'audiovisuel
Jessica Rosselet, productrice
Marie Rosselet-Ruiz, réalisatrice
Gabriele Rossi, éducateur et réalisateur
Christophe Rossignon, producteur
Camille Rouaud, réalisateur
Christian Rouaud, réalisateur
Guillaume Roubaud-Quashie, agrégé et docteur en histoire
Jean Paul Rouve, acteur, réalisateur
David Roux, auteur, réalisateur
Jean Michel Roux, scénariste et réalisateur
Philippe Rouyer, président du Syndicat français de la critique de cinéma
Céline Rouzet, réalisatrice
Emmanuel Roy, réalisateur
Thibaut Ruby, producteur exécutif
Samuel Ruffier, réalisateur
Alexandre Saada, compositeur
Baptiste Saint-Dizier, chef monteur
Michel Saint Jean, producteur, distributeur
Victor Saint-Macary, auteur et réalisateur
Jean-Paul Salomé, cinéaste
Thomas Salvador, réalisateur
Pierre Salvadori, réalisateur
Julien Samani, réalisateur
Rima Samman, réalisatrice et artiste
Natacha Samuel, réalisatrice
Romain Sandère, acteur, réalisateur
Olivier Sarrazin, réalisateur
Simon Sastre, responsable édition vidéo Diaphana
Baptiste Savoie, assistant de production
Régis Sauder, réalisateur
Anne Sauzay, retraitée
Harmel Sbraire, coach théâtre et cinéma
Thomas Schmitt, producteur
Colombe Schneck, auteur et réalisatrice
Pierre Schoeller, réalisateur
Carole Scotta, directrice de Haut et Court
Lizzie Sebban, agent artistique
Dorothée Sebbagh, réalisatrice
Marthe Sébille, réalisatrice
Anne Seibel, cheffe décoratrice
Ina Seghezzi, réalisatrice
Guillaume Senez, réalisateur
Bertrand Seitz, chef décorateur
Reza Serkanian, réalisateur
Louis-Albert Serrut, scénariste et réalisateur
Léa Seydoux, actrice
Natacha Seweryn, programmatrice et chercheuse
Thomas Silberstein, comédien
Caroline Silhol, comédienne
Laura Silhol, agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant
Marion Silhol, metteur en scène et animateur de troupe de théâtre
Nicolas Silhol, réalisateur
Olivier Silhol, organisateur de festival de jazz
Charlotte Silvera, réalisatrice
Bastien Simon, réalisateur
Christopher Simon, réalisateur
Claire Simon, réalisatrice
Justine Simon, comédienne et cinéaste
Morgan Simon, réalisateur
Torren Simonsz, comédien
Ronan Sinquin, chef monteur
Eyal Sivan, réalisateur et producteur
Patrick Sobelman, producteur
Julie Sokolowski, réalisatrice et actrice
Alexandra Sollogoub, scénariste et réalisatrice
Thomas Soliveres, acteur
Nicola Sornaga, réalisateur
Anne Souriau, cheffe monteuse
Gordon Spooner, directeur de la photographie
Boris Spire, exploitant de salles
Heiny Srour, scénariste, réalisatrice et productrice
Alexandre Steiger, réalisateur et comédien
Juliette Steimer, actrice et réalisatrice
Rémi Stengel, ingénieur du son
Anne Suarez, actrice
Brigitte Sy, actrice
Laure Talazac, maquilleuse
Mika Tard, scénariste
Janek Tarkowski, scénariste et réalisateur
Laure Tarnaud, secrétaire générale du cinéma du Réel
Justin Taurand, producteur
Sophie Tavert Macian, scénariste et réalisatrice
Céline Tejero, scénariste et réalisatrice
Novais Teles Marcelo, scénariste et réalisateur
Charles Templon, acteur
Sabine Ternon, réalisatrice
Pascal Tessaud, réalisateur
Laurent Tesseyre, chef décorateur, président de l'ADC
Charles Tesson, délégué général de la Semaine de la Critique
Samuel Theis, réalisateur
Mathias Théry, réalisateur
Pierre-Yves Thieffine, machiniste de construction cinéma
Christopher Thompson, réalisateur
Jean-Pierre Thorn, réalisateur
Laurent Tirard, réalisateur
Catherine Tissier, réalisatrice
Astrid Tonnellier, cheffe décoratrice
Agathe Torti Alcayaga, MCF
Marie-Claude Treilhou, réalisatrice
Annie Tresgot, réalisatrice
Justine Triet, réalisatrice
Gilles Trinques, réalisateur
Mat Troi Day, directeur de production
Martin Tronquart, réalisateur
Dominique Toulat, directeur-programmateur cinéma
Sarah Turoche, chef monteuse
Gaspard Ulliel, acteur
Diego Urgoiti-Moinot, directeur de production
Agnès Valentin, actrice
Vanessa Van Zuylen, productrice
Paula Vandenbussche, productrice, technicienne
Isabelle Vanini, programmatrice
Nicolas Vannier, producteur
Pamela Varela, réalisateur
Alain Veissier, décorateur
Cédric Venail, réalisateur
Philippe Venault, réalisateur
Anaïs Venturi, scénariste et réalisatrice
Matthieu Verhaeghe, producteur
Thomas Verhaeghe, producteur
Martin Verdet, réalisateur
Laure Vermeersch, cinéaste
Béatrice Vernhes, réalisatrice
Aurélien Vernhes-Lermusiaux, réalisateur
Marion Vernoux, réalisatrice
Cyprien Vial, réalisateur
Tatiana Vialle, directrice de casting
Arnaud Viard, réalisateur
Karin Viard, actrice
Jean-Baptiste Viaud, délégué général de la Cinetek
Frédéric Videau, scénariste, réalisateur
Tanguy Viel, écrivain
Alice Vigier, actrice et metteuse en scène
Leslie Villiaume, réalisatrice
Jean-Pierre Vincent, attaché de presse
Pascal-Alex Vincent, réalisateur et enseignant
Claire Viroulaud, attachée de presse
Maxence Voiseux, réalisateur
Alice Voisin, scénariste, réalisatrice
Claire Vorger, attachée de presse, membre du CLAP
Colia Vranici, réalisatrice
Elie Wajeman, réalisateur
Vincent Wang, réalisateur
Ryme Wehbi, productrice
Édouard Weil, producteur
Eduardo Williams, réalisateur
Zoé Wittock, écrivaine, réalisatrice
Éléonore Weber, réalisatrice
Sacha Wolff, réalisateur
Iris Wong, scénariste et romancière
Louise Ylla-Somers, coordinatrice de festival
Luc Wouters, réalisateur
Candice Zaccagnino, productrice
Stéphane Zaubister, photographe
Véronique Zerdoun, productrice
Anne Zinn-Justin, scénariste et réalisatrice
Patrick Zocco, réalisateur
Organisations :
AARSE - Association des auteurs réalisateurs du sud-est
ACDC - Agences de communication du cinéma
ACID - Association du cinéma indépendant pour sa diffusion
ACRIF - Association des cinémas de recherche d’Île-de-France
ADC - Association des chefs décorateurs
Addoc - Association des cinéastes documentaristes
AFCA - Association française du cinéma d’animation
API - Association des producteurs indépendants
ARBRE - Auteurs réalisateurs en Bretagne
ARDA - Association des responsables de distribution artistique
l'ARP - Société civiles des auteurs réalisateurs producteurs
AFSI - Association française du Son à l’Image
Bac Films
BLIC - Bureau de liaison des industries cinématographiques
BUS Films
Carrefour des festivals
CGT Spectacle
Cinémas d'Aujourd'hui Belfort - association de Cinéma Art & Essai
CIP - Cinémas Indépendants Parisiens
CLAP Cinéma - Cercle Libre des attaché(e)s de presse cinéma
DIRE - Distributeurs indépendants réunis européens
EPCC Ciclic Centre Val de Loire
Etna - Atelier de cinéma expérimental
FAMS - Fédération des associations des métiers du scénario
Festival LE TEMPS PRESSE
FNEF - Fédération nationale des éditeurs de films
FOST Studio
L’Agence du court métrage
Les Écrans du Large
Le GREC
Les Monteurs associés
Le Pacte
Moneypenny Productions
Pulp Films
RegardOcc - Collectif des Auteurs.trices-Réalisateurs.trices en Occitanie
ROC - Regroupement des Organisations du Court métrage
SAFIR - Société des auteurs réalisateurs de films indépendants en région
SCAM - Société civile des auteurs multimédia
SDI – Syndicat des Distributeurs Indépendants
Séquences 7 - Association de scénaristes émergents
SFA - Syndicat français des artistes interprètes
SFR CGT - Syndicat français des réalisateurs
SPI - Syndicat des producteurs indépendants
SPIAC CGT - Syndicat des professionnels de l’industrie de l’audiovisuel et du cinéma
SRF - Société des réalisateurs de films
Tënk
The Jokers Films
Union des chefs opérateurs
UPC - Union des producteurs de cinéma
ACID – Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion
ACRIF – Association des cinémas de recherche d'Île-de-France
L'ARP
Carrefour des Festivals
CIP – Cinémas Indépendants Parisiens
AFCAE – Association française des Cinémas Art et Essai
AFCA – Association française du cinéma d'animation
L'Agence du court métrage
DIRE - Syndicat des distributeurs indépendants réunis européens
FACC – Fédération de l'action culturelle cinématographique
La Fédération des associations des métiers du scénario
GNCR – Groupement National des Cinémas de Recherche
Images en bibliothèques
Passeurs d'images
ROC – Regroupement des Organisations du Court métrage
SCARE - Syndicat des Cinémas d'Art, de Répertoire et d'Essai
SDI – Syndicat des distributeurs indépendants
SRF – Société des réalisateurs de films
Communiqué
Le 17 février 2021
Non à la fermeture des options artistiques au lycée
Faire un film est un travail d'équipe ; le faire aimer également. Nous, les organisations cinématographiques partenaires des lycées à options cinéma, sommes très inquiets de voir les options artistiques menacées au sein des lycées, et avec elles, le travail au long cours mené depuis des années par les enseignants et leurs équipes pédagogiques, en collaboration avec les professionnels du cinéma.
Dans un contexte de crise sans précédent, alors que les pratiques culturelles des plus jeunes sont en phase de transformation radicale, les acteurs de la diffusion cinématographique s'alarment de la disparition programmée des options facultatives cinéma dans les lycées en France. Les options artistiques permettent un accès approfondi à celles et ceux qui le veulent, à l'art, de façon égalitaire. Cette disparition annoncée, pour une offre de spécialité qui touchera un public beaucoup plus restreint, force les élèves les plus éloignés du monde de la culture à s'en passer complètement. Ceci constitue une grave mise en danger de l'accès à toutes et tous à la culture et de la formation des regards.
La défense des valeurs émancipatrices de la culture pour la jeunesse, de l'importance de l'éducation artistique, de la nécessité de développer la cinéphilie des plus jeunes générations afin de permettre l'appropriation par chacun d'une plus grande diversité d'objets culturels, est un travail collectif auquel les équipes pédagogiques prennent leur part. Ce travail mené sur le temps scolaire est l'un des piliers du renouvellement et rajeunissement du public dans les salles. Une politique culturelle ambitieuse pour la jeunesse ne saurait être mise en œuvre par des restrictions budgétaires à cet endroit.
La défense de ces missions d'éducation à l'image que nous soutenons, définies comme prioritaires par la puissance publique et le CNC, est mise en danger par cette décision structurelle et budgétaire du Ministère de l'Éducation nationale, faisant porter aux seuls lycées l'organisation et le coût des heures d'options artistiques facultatives.
Partenaires des équipes pédagogiques qui les font vivre depuis leur création, nous rappelons l'importance de ces options artistiques facultatives pour la société, et demandons au Ministère de l'Éducation nationale, au Ministère de la Culture d'en assurer la pérennité. A rebours des politiques budgétaires restrictives, garantir à toutes et tous un meilleur accès à la culture implique de maintenir et développer une politique d'éducation à l'image forte en faveur du cinéma en France.
Nous soutenons la tribune publiée dans Libération, initiée par les enseignantes et enseignants de cinéma à Paris et signée par plus de 300 personnalités du cinéma et de la culture.
Nous appelons à la signer via la pétition en ligne.
Contact presse : Rosalie Brun /rbrun@la-srf.fr/ 01.44.89.62.58
Tribune initiée par les enseignantes et enseignants de cinéma à Paris, signée par Jacques Audiard, Louise Bourgoin, Cédric Klapisch, Laurent Cantet… et près de 300 personnalités du cinéma et de la culture, enseignants, anciens élèves et parents d’élèves.
"Entrer dans l’option Cinéma a été la meilleure décision de ma vie. – Cela m’a permis d’avoir une meilleure compréhension du monde. Car les films font avancer le spectateur.’’
Ecoutons les lycéens. Ils disent la richesse de l’enseignement du cinéma. Richesse car ils y apprennent à analyser des films de tous horizons. Richesse car ils y expérimentent le travail de groupe. L’enseignement du cinéma, comme le cinéma lui-même, est un travail d’équipes. Equipes de lycéens qui vivent au plus près l’acte de création. Equipes d’adultes qui les accompagnent dans cette découverte d’eux-mêmes et du monde : enseignants, intervenants professionnels, organisateurs de festivals, gérants de salles, réalisateurs et autres acteurs de l’art et de l’industrie cinématographiques. Richesse car cette forme d’apprentissage, démultipliant les lieux et les référents adultes, permet à des adolescents, adultes et citoyens en devenir, de se confronter à des idées multiples et originales, d’apprendre à se questionner, à forger leur regard sur le monde.
Or, face à ces enthousiasmes, l’institution et le pouvoir politique proposent actuellement une réponse mortifère. Les discours sur la réforme du lycée s’articulent autour d’un surcroît de liberté. Pour les élèves par le choix des spécialités, notamment artistiques. Pour les équipes pédagogiques par la possibilité de déterminer elles-mêmes l’utilisation d’une partie de leurs moyens horaires. Ces discours sont un trompe-l’œil.
La réalité est celle d’une politique budgétaire restrictive, qui grève l’offre pédagogique existante. Et les enseignements artistiques sont en première ligne. Les enseignements optionnels artistiques sont en train de disparaître : le nouveau baccalauréat les marginalise et ils sont les premières victimes de la diminution des heures allouées aux établissements. Or, ils accueillent un grand nombre d’élèves, et surtout s’adressent autant aux élèves de l’enseignement général qu’à ceux de l’enseignement technique, pour lesquels ils représentent le seul accès à l’art et à la culture.
L’existence des spécialités ne peut compenser cette perte, d’autant que l’obligation de ne garder, en Terminale, que deux des trois spécialités de Première et la pression de Parcoursup les fragilisent face à des matières plus traditionnelles, et donc rassurantes.
Ce choix de société nous paraît profondément injuste et totalement incompatible avec la mission républicaine de l’Education Nationale. L’art n’est pas un ‘’bonus’’ : on ne peut en restreindre l’accès sans dommage. La crise sanitaire que nous traversons le montre à l’envi. Plus que jamais, nous nous tournons vers les œuvres, nous cherchons des moyens de continuer à les faire vivre. La culture est aussi un secteur économique qui irrigue toute la société, par les professionnels qu’elle emploie et par l’esprit critique, le rêve qu’elle propose à tous. L’enseignement artistique participe de cette fonction sociale et politique.
Les lycéens en cinéma vont dans les salles, y entraînent leurs amis, leurs familles. Ils en renouvellent le public. Ils expérimentent très tôt ce que chaque spectateur de cinéma a un jour ressenti dans une salle : une communion collective à travers des émotions partagées qui amènent à la réflexion.
L’enseignement du cinéma crée des spectateurs, des esprits libres et ouverts sur le monde.
Écoutons les lycéens. ‘’Plongée dans un bain que je ne connaissais pas, j’ai avancé les yeux fermés jusqu’à une salle de cinéma : la lumière qui s’éteint, et mes yeux qui s’ouvrent…’’
Premiers signataires :
Lisa ABITBOL ancienne élève en spécialité cinéma, chargée de casting
Toméo ABDELLI-SAVIN, ancien élève d’option Cinéma et étudiant en Droit
Mickaël ADARVE, étudiant en L1 Cinéma
Ali AKIKA, réalisateur
Matthias ALAGUILLAUME, professeur de Cinéma
Fleur ALBERT, réalisatrice
Karim ALLAG, responsable de diffusion
Gwenael ALLAN, producteur culturel
Anne ALVARO, comédienne
Cristèle ALVES MEIRA, cinéaste
Camille ARNAUD, photographe et graphiste
Agathe ARNOLD, enseignante
Ariane ASCARIDE, comédienne
Jacques AUDIARD, réalisateur
Olivier BABINET, cinéaste
Guillaume BACHY, directeur et programmateur des Cinémas du Palais, ancien élève d'option Cinéma, père d'une ancienne élève d’option Cinéma
Béatrice BAILET, artiste plasticienne
Jean-Marie BALDNER, historien-géographe et critique
Anton BALEKDJIAN, ancien élève d’option Cinéma, diplômé de La Cinéfabrique, département scénario
Véronique BALMAND
Pascale BALME, professeure de SVT au lycée Racine
Adriana BARBATO, ancienne élève de l’enseignement Histoire des Arts, scénariste
Aurélia BARBET, cinéaste
Jérôme BARON, directeur artistique et enseignant en Cinéma
Antoine BARRAUD, réalisateur
Antarès BASSIS, parent d’élève, auteur-réalisateur
Luc BATTISTON, réalisateur
Stéphane BATUT, cinéaste
Sophie BEAUDOIN, parent d'élève
Gilles BEDEJUS, professeur agrégé de Sciences sociales
Noémie BENHARROUS, ancienne élève d’option Cinéma, étudiante en droit
Aude BERAS, ancienne élève d’option Cinéma, master2 de Politiques urbaines (IEP de Lyon)
Michel BERTROU, journaliste
Julie BERTUCCELLI, réalisatrice, co-directrice du département Réalisation à la Fémis, Présidente de La Cinémathèque du Documentaire
Stéphanie BESNARD, professeur en économie-gestion, lycée H de Balzac, Paris
Thomas BIDEGAIN, scénariste
Alexis BLANCHET, ancien élève d’option cinéma, maître de conférences Département Cinéma et Audiovisuel Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel (Ircav)
Myriam BLOEDE, CNRS - Paris
Alan BLUM, enseignant pour les techniques audio à l'ENS Louis Lumière
Clément BORDERIE, artiste
Julia BORDERIE, artiste plasticienne
Aurélie BORDIER, déléguée générale de l’ACID
Claudine et Patrice BORIES, cinéastes
Lucie BORLETEAU, réalisateur
Sabine BOUCKAERT, maître de conférences Paris 8-Université
Sophie BOUFERROU, ancien élève d’option Cinéma, attachée territoriale
Louise BOURGOIN, comédienne
Perrine BOUTIN, maître de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle
Sophie BOUTOUYRIE, professeur de lettres modernes, lycée H de Balzac, Paris
Guillaume BRAC, réalisateur
Marion BRAYER, chargée des activités scolaires au Forum des images
Nicole BRENEZ professeur, Département Cinéma et Audiovisuel, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Basile BRETAGNE, ancien élève d’option Cinéma, chômeur
Marie Violaine BRINCARD, cinéaste et parent d’élève
Geneviève BRISAC, écrivaine
Émilie BRISAVOINE, réalisatrice
Olivier BROCHE, comédien
Mikael BUCH, réalisateur
Jude BUTEL-GANS, ancien élève d’option Cinéma, étudiant à l’ENS - Lyon
Lily CANDALH-TOUTA, directrice adjointe aux activités pour adolescent.es et aux formations adultes au Forum des Images
Laurent CANTET, réalisateur
Marie CANTET, ancienne élève d’option cinéma, directrice de casting
Isabelle CAPITAINE BENNE, professeure de Lettres, en charge d'une option théâtre au lycée Pasteur, Besançon
Sylvie CARCEDO, chef opératrice, enseignante à l'ENS Louis Lumière
Oona CARTERON, ancienne élève d’option Cinéma et étudiante en Histoire
Yannick CASANOVA, cadreur, directeur artistique, directeur de casting
Otilia CASTEELS-DA COSTA, ancienne élève d’option Cinéma, script
Teresa CASTRO, maître de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles, responsable Erasmus et échanges internationaux, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Isabelle CHAMBOST, parent d’élève, enseignant-chercheur, Conservatoire national des arts et métiers
Frédéric CHERBOEUF, comédien, metteur scène, parent d’élève
Ahcène CHERIET, CPE, lycée H de Balzac, Paris
Malik CHIBANE, réalisateur
Patric CHIHA, réalisateur
Marielle CLOT, gestionnaire RH laboratoire de recherche du CNRS Christophe COGNET, réalisateur
Lola CIRES, ancienne élève d’option Cinéma, étudiante en master 1 d’Arts plastiques et en Art Dramatique au conservatoire Paul Dukas
Romain COGITORE, réalisateur
Emmanuelle CONSO, productrice exécutive, directrice de production
Abel CORIDIAN, ancien élève d’option Cinéma, étudiant en licence de Cinéma à Paris Diderot
Clotilde CORNUT, chargée de mission arts et culture au Réseau Canopé
Catherine CORSINI, réalisatrice
Samuel COULON, parent d’élève
Marie-Christine COURTES, réalisatrice et scénariste
Annick COURTIN, professeure de Lettres classiques, lycée Honoré de Balzac
Laurence COUSTEIX, professeure de cinéma en CPGE
Julie CRENN, historienne de l'art & commissaire d'expositions
Fanny DAL MAGRO, professeure de Cinéma, lycée Jean Monnet de Franconville
David DALEM, enseignant
Florent DARMON, réalisateur et professeur, intervenant cinéma
Jean-Pierre DARROUSSIN, comédien
Romain DAUM, service civique à l’ACID
Valérie DE MEERLEER, graphiste indépendant
Isabelle DE MOURA, parent d’élève
Marina DEAK, réalisatrice
Théo DELMONT, ancien élève d’option Cinéma, étudiant en sciences sociales
Delphine DELOGET, cinéaste
Anaïs DEMOUSTIER, comédienne
Stéphane DEMOUSTIER, réalisateur
Claire DENIS, réalisatrice
Caroline DERUAS, réalisatrice
Camille DESCATEAUX, ancienne élève d’option Cinéma, étudiante en sciences sociales (IEP de Paris)
Amélie DESCHAMPS, artiste - arts visuels
Sylvain DESCLOUS, réalisateur
Isabelle DESCOURS, professeure d’arts plastiques
Pascal DEUX, réalisateur
Émérance DUBAS, réalisatrice
Olivier DURY, cinéaste
Chloé DUVAL, cinéaste
Pierre EGAL
Léoxanne ELFORT, ancienne élève d’option Cinéma
Liam ENGLE, réalisateur
Annie ERNAUX, écrivaine
Francois FARELLACCI, réalisateur
Frédéric FARRUCCI, réalisateur
Kristian FEIGELSON, Sociologue, Professeur des Universités (Ircav/ Sorbonne-Nouvelle)
Pascale FERRAN, réalisatrice
Régine FERTILLET, coordinatrice Projet Neuf Libre Lieu artistique – Saint-Nazaire
Simon FEYDIEU, artiste et enseignant
Caroline FILLIETTE, journaliste, coordinatrice d’émission
Aline FISCHER, réalisatrice
Ferdinand FLAME, ancien élève d’option Cinéma, metteur en scène
Thomas FRAIN, producteur et directeur de production
Fabrice FRANK, producteur
Jean-Luc GAGET, scénariste et dialoguiste
Stéphanie GARCIN-ALEXIS, enseignante agrégée de lettres modernes, lycée H de Balzac (Paris)
Philippe GARREL, réalisateur
Antoine GAUDIN, maître de conférences en Etudes cinématographiques à l'Université Sorbonne nouvelle
Dyana GAYE, réalisatrice
Elisa GEAY, ancienne élève d’option cinéma, assistante sociale
Laurent GEHANT, musicien
Chloé GENESTE, ancienne élève d’option Cinéma, missions dans des Festivals de Cinéma
Raphaël GOLDSZAL, étudiant en 3ème année à La Fémis en montage, ancien élève d’option cinéma
Barbara GOMBIN, professeure de Cinéma
Laure GONAY, ancienne élève d’option Cinéma et étudiante en management des institutions culturelles
Jean-Louis GONNET, cinéaste et intervenant cinéma
Francois GOUBLET consultant
Martin GOUTTE, MCF Département Cinéma & Audiovisuel, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audiovisuel (EA 185)
Diego GOVERNATORI, cinéaste
Evgenia GIANNOURI, maître de conférences département Cinéma et Audiovisuel et directrice adjointe du département
Pauline GINOT, déléguée générale adjointe de l’ACID
Emmanuel GRAS, réalisateur
Eugène GREEN, cinéaste
Delphine GRENEZ, professeure agrégée d'Histoire
Georges GROULT, retraité - ancien Producteur INA
Robert GUEDIGUIAN, réalisateur
Rémi GUELFI, ancien élève d’option Cinéma, électricien de plateau
Joana HADJITHOMAS, réalisatrice
Rachid HAMI, réalisateur
Cyrille HANAPPE, Architecte et Ingénieur
Ted HARDY-CARNAC, réalisateur
Judith HENRY, comédienne
Ludovic HENRY, producteur
Françoise HERBET-PAIN, coach linguistique pour comédiens étrangers
Morgane HIET, professeur des écoles
Sophie HIET, parent d’élève, scénariste
Esther HOFFENBERG, réalisatrice, productrice
Raphaël JACOULOT, réalisateur et enseignant-intervenant
Manon JACQUEMIN-FOUDRAT, ancienne élève d’option Cinéma, professeure de Français Langue étrangère
Basile JAY, étudiant en Master de virologie
Audrey JEAN-BAPTISTE, réalisatrice
Thomas JENKOE, réalisateur
Chrystel JUBIEN, cinéaste
David JUNGMAN, réalisateur / monteur
Natacha KAGANSKI, ancienne élève d’option cinéma, distributrice de films
Naruna KAPLAN DE MACEDO, cinéaste
Vergine KEATON, réalisatrice
Charif KIWAN, parent d’élève
Maya KIWAN, parent d’élève
Cédric KLAPISCH, réalisateur
Héléna KLOTZ, réalisatrice
Mariam KONE, ancienne élève d’option cinéma, journaliste
Julia KOWALSKI, réalisatrice
Nathalie KUPERMAN, écrivaine
Pascale LABADIE, professeur de lettres classiques, lycée H de Balzac
Alexandre LABARUSSIAT, réalisateur
Gautier LABRUSSE, président du GNCR, directeur du Cinéma LUX à Caen
Philippe LAINE, réalisateur
Xavier LAINE, écrivain
Daisy LAMOTHE, réalisatrice
Alexandre LANCA, cinéaste
Aure LAPIERRE-RENARD, ancienne élève d’option Cinéma, étudiante en Histoire de l’Art et de la Mode à l’Ecole du Louvre
Jeanne LAPOIRIE, directrice de la photographie
Marion LARY, réalisatrice
Laurie LASSALLE, réalisatrice
Monique LATHELIER, Agrégée de Lettres Modernes, Professeur de Lettres et de Cinéma retraitée
Sébastien LAUDENBACH, réalisateur
Florence LAURIOL, professeure de Cinéma
Gaëlle LAUTRU, comédienne
Fanny LAYANIE, professeure d’histoire-géographie, lycée H de Balzac, Paris
Anne LE BOUFFANT, ancienne élève d'option et spécialité cinéma audiovisuel, monteuse et assistante technique
F. LECRONT
Eloïse LE GALLO, artiste plasticienne et professeure de sculpture
Cyril LE GRIX, réalisateur
Gilles LE MAO, réalisateur, producteur
Serge LE PERON, réalisateur
Loïc LEGENDRE, comédien
Aude LEMEUNIER, professeure de Cinéma
Sophie LEMP, parent d’élève
Rainer LEMP, parent d’élève
Blandine LENOIR, cinéaste
Laurence LEROY, professeure de Cinéma
Alexandre LETER, réalisateur
Aline LETROU, chargée de production /Documentaires
Guillaume LEVIL, cinéaste
Ombline LEY, cinéaste
Sébastien LIFSHITZ, réalisateur
Véronique LORIN, enseignante de montage et workflows à l’ENS Louis-Lumière, monteuse
Jules MACHICOT, ancien élève d’option Cinéma et étudiant en école d’effets spéciaux
Catherine MAGISTRY, professeure de Cinéma
Stéphanie MAGNANT, réalisatrice
Johanna MAKABI, ancienne élève d’option cinéma, directrice de Casting
Elodie MANDIN, professeure de Cinéma
Audrey MARCHAL, parent d’élève
Pascal MARTIN, professeur des Universités, ENS Louis Lumiere
Romain MASSON, ancien élève de l’enseignement Cinéma, réalisateur et producteur radio
Angeline MASSONI, directrice de production
François MAURIN, artiste plasticien
Audrey MAURION, chef monteuse
Nora MARTIROSYAN, cinéaste
Maurane MAZARS, ancienne élève d’option Cinéma, autrice de bandes dessinées
Alexis MESPLEDES, ancien élève d’option Cinéma, skiman
Sabine MEIER, professeur d'arts plastiques en spécialité
Hélène MILANO, cinéaste
Fanny MILLOT, ancienne élève d’option Cinéma, étudiante en Anglais/Cinéma à l’Université Paris Diderot
Catherine MIOT, professeure agrégée d’histoire et de géographie, retraitée, professeure principale pendant plus de 10 ans de la classe de seconde option théâtre (lycée Marc Chagall - Reims)
Tatiana MONASSA, ATER, département Cinéma et audiovisuel, Université Sorbonne nouvelle-Paris 3
Cédric MONTEL, professeur de Cinéma en Spécialité et Option - Lycée Louise Michel Bobigny
Sébastien MONTERO, enseignant école d'art
Alain MOREAU, scénariste, ancien élève d’une option Cinéma
Hugo MOREAU, ancien élève d’option Cinéma et étudiant en master Patrimoines Audiovisuels
Maureen MOUZAT, assistante accessoiriste
Frédéric MOYER, professeur d'économie et de droit, lycée Turgot
Léa MYSIUS, réalisatrice
Audrey NAIT-CHALLAL, parent d’élève
Aline NAMESSI, ancienne élève d’option cinéma, psychologue clinicienne
Julie NAVARRE, parent d’élèves FCPE
Barbara NAVI, peintre
Laure NEEL-HUBERT, enseignante de Lettres modernes, lycée H de Balzac
Charlotte NERI, ancienne élève de spécialité Cinéma, étudiante à la Femis
Liéna NICOLLE, ancienne élève d’option Cinéma, diplômée d’école de Cinéma, monteuse
Nathan NICHOLOVITCH, réalisateur
Louise NIZAN, ancienne élève d’option Cinéma, étudiante en master Didactique de l’Image à Paris Sorbonne Nouvelle
Véronique NOLLET, cadre fonction publique au Ministère de la Culture
Anna NOVION, réalisatrice
Ambre NOWACK, ancienne élève d’option cinéma, étudiante en Master 1 Direction de projets et établissements culturels
Melody OBADIA, ancienne élève d’option cinéma, cheffe monteuse vidéo
Valérie OSOUF, réalisateur
Mariana OTERO, réalisatrice
Jules PANDOLFI, ancien élève d’option cinéma, étudiant en Master en image INSAS
Noémie PARREAUX, ancienne élève en option cinéma, étudiante à la Fémis
Célia PASCAL, professeure de Lettres Modernes
Victoire PATOUILLARD, professeure de Cinéma au Lycée français de New York
Thomas PAULOT, ancien élève d’option cinéma, réalisateur
Elisabeth PEREZ, productrice
Monique PEREZ, réalisatrice
Vladimir PERISIC, cinéaste
Dominique PETROT, monteur de cinéma/télévision, formateur montage
Nicolas PHILIBERT, cinéaste
Zelina PICARD-BONI, ancienne élève d’option cinéma, monteuse
Thomas PILLARD, maître de conférences en cinéma et audiovisuel, Université Sorbonne Nouvelle
Pierre PINAUD, cinéaste
Lila PINELL, réalisatrice
Jérôme PLON, réalisateur photographe, intervenant cinéma dans les dispositifs d'éducation à l'image
Lou-Anne POINOT, étudiante en production cinématographique, stage à la SRF
Philippe PONCIN, Société ALEF, Arbres Littérature Échanges Fraternité
Suzanne PONT, ancienne élève d’option Cinéma, étudiante en direction de production au CLCF
Karine PORIER, guide conférencière
Mathilde PRA, professeure de philosophie, lycée Turgot
Jérôme PRIEUR, Cinéaste et écrivain
Fanny PRIVAT, ancienne élève d’option Cinéma, cartographe
Amira RAHAL, ancienne élève en spécialité Cinéma, étudiante en licence de cinéma
Karin RAMETTE, chargée des publics à l’ACID
Natacha REGNIER, comédienne
Caroline RENARD, Maîtresse de conférences en études cinématographiques, Aix-Marseille Université
Maïa REITCHESS, professeure de Cinéma
Anne-Marie REY, professeure d’Arts Plastiques
Giulia RICHARD, ancienne élève d’option Cinéma, étudiante en master 1 Réalisation et Création – Paris 8
Simon RICORDEAU-CHEN, ancien élève d’option Cinéma, étudiant en master d’anthropologie visuelle à Paris Nanterre
Famille ROBICHON-DETOURNAY, parents d’élève
Marie ROBIN, parent d’élève
Séverine ROCABOY, directrice programmatrice du cinéma Les Toiles de Saint Gratien
Axelle ROPERT, réalisatrice
Camille ROSA, artiste plasticienne scénographe et enseignante
Julie-Anne ROTH, comédienne et metteur en scène
Christian ROUAUD, réalisateur
Delphine ROZAN, professeur de lettres modernes, lycée H de Balzac, Paris
Mila RYNGAERT, ancienne élève d’option Cinéma, étudiante en réalisation (IAD)
Pierre SALVADORI, réalisateur
Régis SAUDER, réalisateur
Céline SAVOLDELLI, ancienne élève en spécialité Cinéma, scripte Cinéma
Clément SCHNEIDER, cinéaste
Ina SEGHEZZI, réalisatrice
Idir SERGHINE, cinéaste
Christophe SEUREAU, artiste-auteur, parent d’élève
Léandre SEUREAU, étudiant en Art
Valentine SEUREAU, ancienne élève de l’option cinéma à Sophie Germain- Assistante Monteuse / Etudiante en Scénario
Claire SIMON, réalisatrice
Yann SIMON, parent d’élève
Yves SMADJA, directeur de production et post-production
Antonio SOMAINI, professeur en études cinématographiques, études visuelles, théorie des
médias
François SOULAGES, professeur des universités Paris 8 & INHA, président-fondateur de RETINA International
Paulina SPUCCHES, ancienne élève d’option cinéma, autrice et illustratrice
Guillaume SOULEZ, professeur, directeur de l’Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel - IRCAV - EA 185, Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Matthias STEINLE, Maître de conférences, Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audiovisuel (IRCAV), Département Cinéma et audiovisuel, Université Sorbonne Nouvelle
Eric TALBOT, attaché de presse évoluant dans le secteur culturel
Sophie TAVERT MACIAN, cinéaste
Paola TERMINE, monteuse
Céline TERS, réalisatrice France Culture /Radio France
Louis THINES, ancien élève de l’enseignement Cinéma, assistant aux services Presse et Protocole en festivals
Tao THOMAS, ancien élève d’option Cinéma, étudiant en licence 1 de cinéma à Paris 1 Panthéon Sorbonne
Antonin TOKATLIAN, ancien élève d’option cinéma, cadre chez Airbus Helicopters
Sophie TORLOTIN-ANFOSSO
Martin TRONQUART, cinéaste
Marion TRUCHAUD, réalisatrice
Christelle VAUX-DEVE, enseignante en option cinéma au Lycée Rotrou (Dreux)
Lise VAYSSIERES, réalisatrice
Cédric VENAIL, réalisateur
Basile VERDEAU, ancien élève d’option Cinéma, étudiant ingénieur
Florence VERDEILLE, parent d’élève
Aurélie VERILLON, parent d’élève et comédienne
Laure VERMEERSCH, cinéaste
Marie VERMILLARD, réalisatrice
Aurélien VERNHES LERMUSIAUX, réalisateur
Marion VERNOUX, réalisatrice
Laure VERNY, ancienne élève d’option cinéma, ancienne projectionniste, cadre comptable à l’ADMR
Jean-Robert VIALLET, cinéaste
Alice VIEILLY, ancienne élève d’option Cinéma, étudiante en Cinéma à Paris 8
Victor VILACEQUE, ancien élève d’option Cinéma, gérant de Monkeye Production
Pascal-Alex VINCENT, cinéaste et enseignant
Maria VIVAS, parent d'élève
Maxence VOISEUX, réalisateur
Eléonore WEBER, réalisatrice
Bernard WIRKEL, retraité
Zoé WITTOCK, réalisatrice
Adèle YVON, ancienne élève d’option Cinéma, responsable de projet audiovisuelles
Valérie ZENATTI, écrivain, scénariste
Valentine ZERR, lycéenne en classe de Terminale, lycée Pasteur (Besançon)
Soutenue par :
ACID - Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion
CIP - Cinémas Indépendants Parisiens
CGT Education Paris
AFCAE – Association française des Cinémas Art et Essai
AFCA - Association française du cinéma d'animation
L’Agence du court métrage
L'ARP
Département Cinéma et Audiovisuel de la Sorbonne Nouvelle
FACC – Fédération de l'action culturelle cinématographique
Festival des Trois Continents - Nantes
La Fédération des associations des métiers du scénario
Les élus FCPE du Lycée TURGOT, Paris
GNCR - Groupement National des Cinémas de Recherche
IRCAV - Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel - EA 185, Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3
ROC - Regroupement des Organisations du Court métrage
SCARE - Syndicat des Cinémas d'Art, de Répertoire et d'Essai
SRF - Société des réalisateurs de films
Les Ailes du Désir - ANEPCCAV - Association Nationale des Enseignants et Partenaires culturels des Classes Cinéma et Audiovisuel